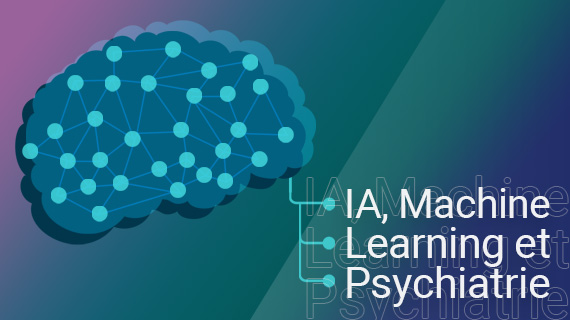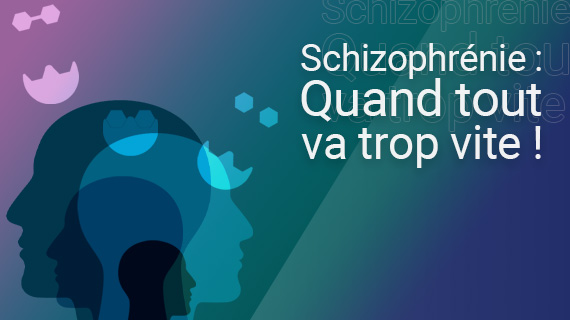Félicitations aux lauréats de l'Encéphale 2017 !
Prix du Congrès
Mindwandering et mémoire autobiographique dans la dysphorie
GUESDON A.(1), ROTGÉ J-Y.(1), KVAVILASHVILI L.(2), FOSSATI P.(1)
(1) Pitié-Salpêtrière/ICM, Paris, FRANCE
(2) University of Hertfordshire, HATFIELD, ROYAUME-UNI
Background : La mémoire autobiographique permet à chacun de construire un sentiment d’identité et de continuité dans le temps et l’espace. La mémoire autobiographique volontaire (MAV) est moins spécifique chez les patients présentant un épisode dépressif majeur par rapport aux sujets sains. L’influence des troubles dépressifs est-elle la même sur les souvenirs qui se présentent à nous spontanément (Mémoire Autobiographique Spontanée – MAS)? Le phénomène de remémoration spontanée s’inscrit dans le processus de mind-wandering (MW), ou vagabondage de l’esprit. En effet il constitue une partie du flux de nos pensées lorsque notre esprit se détache de l’activité en cours et vagabonde. Cette propension à se déconcentrer est plus importante chez les patients dépressifs, et leur MW serait plus dirigées vers le passé comparativement à des sujets contrôles.
Objectifs : Ce travail a pour objectif d’étudier le MW, la MAS et la MAV chez des sujets dysphoriques non déprimés (définis par des scores élevés à la Beck Depression Inventory scale, BDI) et des sujets non dysphoriques. Notre hypothèse était que les sujets dysphoriques présenteraient plus de MW dirigé vers le passé, donc plus de MAS que les sujets non dysphoriques. Les caractéristiques en terme de spécificité (détails des souvenirs) et de point de vue de la MAS ne seraient en revanche pas ou peu modifiées, contrairement à celles de la mémoire volontaire.
Matériels et méthodes : 16 sujets dysphoriques (score BDI>15, age moyen=22,3 +-SD=2,1, BDI moyen=21,8 +-SD=5,6) et 37 sujets non-dysphoriques (score BDI<8, age moyen = 26 ans+- SD= 5,9, BDI moyen = 2 +-SD= 1,5) ont été évalués au moyen de deux tâches monotones d’attention au cours desquelles des sondes de pensée se présentaient aléatoirement, évaluant la nature et les caractéristiques de la pensée du sujet. Chaque sujet a également complété une tâche de mémoire volontaire.
Résultats : Nous avons observé plus de pensées non liées à la tâche dans le groupe dysphorique (D) que dans le groupe non dysphorique (ND) (D = 8,5 ET= 0 ,7 , ND = 5 ET=1, p <0.03). Ces pensées n’étaient pas plus dirigées vers le passé dans le groupe dysphorique. Les souvenirs involontaires étaient moins spécifiques dans le groupe dysphorique que dans le groupe non dysphorique (D = 2,6, ET= 1,1 ND= 2,6 ET=1,5 p<0.05). Le positionnement des sujets dans leurs pensées involontaires était plus spectateur dans le groupe dysphorique que dans le groupe non dysphorique. La valence émotionnelle des souvenirs volontaires et spontanés ne différait pas entre les deux groupes.
Conclusion : Une partie de nos résultats converge avec nos hypothèses et avec la littérature s’intéressant à la dépression, notamment concernant la propension à faire plus de MW et à avoir un positionnement plus spectateur dans les pensées. Ces résultats constituent un faisceau d’argument en faveur d’une dysrégulation du MW par une voie plus cognitive qu’émotionnelle dans la dysphorie.
Prix du Comité Scientifique
La compassion et la Compréhension émotionnelle chez les Médecins Marocains
JAAFARI M., KAYCHOUH M., TABRIL T., AARAB C., AALOUANE R., RAMMOUZ I.
CHU Hassan 2, Fès, MAROC
Introduction : L’empathie est un facteur thérapeutique très important en Médecine et en Chirurgie. Elle comprend la compassion et la compréhension émotionnelle. La compassion commence par la reconnaissance de la souffrance du patient, accompagnée d'une réponse interne à cette souffrance (appelée souvent la résonance émotionnelle) puis exprimer cette souffrance par des mots et actions.
L’objectif de cette étude est de :- mesurer cette compassion chez les étudiants en médecine (futures médecins) qui sont déjà en contact avec les malades au cours des stages hospitaliers ; et chez les pratiquants au ceins du Centre Hospitalier universitaire Hassan 2 de Fès;
-Rechercher les facteurs influancant cette compassion;
- Et enfin donner des recommandations pour agir et améliorer cette compassion.
Matériels et Méthodes : Il s’agit d’une étude transversale à visée analytique qui a été réalisée au centre universitaire hospitalier Hassan 2 de Fès, auprès de 632 étudiants en médecine (du 3éme année au 6éme année) qui font des stages hospitaliers et 300 médecins internes et résidents. Les participants ont répondu à un questionnaire constitué des données socio démographiques, des questions concernant les conditions du stage ou du travail, la nature de spécialité, le financement des études et la nature du contrat pour les médecins résidents, et enfin ils ont rempli l’échelle d’empathie de Jefferson. Nous intéressons dans ce travail à 10 questions de cette échelle qui mesurent la compassion et la compréhension émotionnelle (score entre 10-70). Le traitement statistique a été réalisé par le logiciel SPSS 20.0.
Résultats : Parmi les 932 qui ont participé à notre enquête ,61% étaient de sexe féminin, la moyenne d’âge était de 23.7 ans (DS :3.06). Seulement 21% des étudiants avaient une bourse, alors que 51 % de nos médecins résidents étaient contractuels. 34.3% des médecins internes et résidents étaient mariés, dont 41% parmi eux ont déjà des enfants. Dans notre échantillon le score moyen de la compassion et la compréhension émotionnelle était de 36.46 ( DS :7.71). L’ analyse statistique a trouvé que le sexe féminin , l’âge, le statut professionnel , les bonnes conditions de vivre comme le fait d’être marié , avoir une bourse , avoir un contrat et un bon salaire, sont des facteurs qui influencent significativement la compassion et la compréhension émotionnelle chez les étudiants et les médecins (p<0.05).
Conclusion : Notre travail a permis de mettre en avant le lien entre la compassion et le bien-être. Nous avons apporté plusieurs éléments robustes montrant que le bien-être du médecin lui permet une meilleure compréhension des émotions du patient et par conséquence une meilleure empathie.
Prix du poster
Le décodage facial dans la schizophrénie dépend des déficiences du traitement visuel de base
BELGE J-B.(1), MAURAGE P.(2), MANGELINCKX C.(2), LELEUX D.(3), DELATTE B.(4), CONSTANT E.(1)
(1) Universités Catholiques de Louvain, Bruxelles, BELGIQUE
(2) Laboratoire de Psychopathologie expérimentale, LOUVAIN-LA-NEUVE, BELGIQUE
(3) Cliniques Sanatia, BRUXELLES, BELGIQUE
(4) Hôpital Psychiatrique du Beau Vallon, NAMUR, BELGIQUE
Introduction : La schizophrénie est caractérisée par un déficit important dans le décodage des expressions faciales émotionnelles (EFE). Néanmoins, il n’est pas encore clair si ce déficit est spécifique pour la reconnaissance des émotions ou causé par une déficience plus générale dans le traitement visuel ou faciale.
Trente-deux sujets souffrant de schizophrénie comparée à 32 sujets sains, ont exécuté plusieurs tâches, évaluant la reconnaissance des deux aspects faciaux : les aspects variables à l’aide de tâches d’orientation et de tâches de reconnaissance émotionnelle ; et les aspects invariables à l’aide de tâches de reconnaissance d’âge et du genre. La vitesse de traitement et les performances ont été enregistrées.
Les patients souffrant de schizophrénie ont présenté un déficit de performance et de vitesse de traitement dans la perception des aspects facials variables et invariables, sans aucun déficit spécifique pour le décodage émotionnel.
Performances : un effet principal du groupe [F(1,62)=18.98, p<0.001] a été découvert, les patients schizophrènes présentant des scores de précision réduits. Aucun effet principal pour la tâche [F(1,62)=1.96, NS] et aucune interaction [F(1,62)=0.61, NS] n’ont été découverts.
Vitesse de traitement : un effet principal du groupe [F(1,62)=43.99, p<0.001] a été découvert, les patients souffrant de schizophrénie étaient globalement plus lents que les contrôles. Nous avons découvert un effet principal significatif de la tâche [F(1,62)=3.52, p<0.05]: la tâche de reconnaissance du genre a été associée à des réponses plus rapides que les tâches de reconnaissance d’âge [t(63)=3.19, p<0.01], et de reconnaissance émotionnelle [t(63)=2.86, p<0.01], les autres différences étant non-significatives. Une interaction significative a été découverte [F(1,62)=3.97, p<0.05]: dans le groupe de contrôle, des temps de réponse plus rapides ont été découverts pour la tâche d’orientation par comparaison à la tâche de reconnaissance du genre [t(31)=2.23, p<0.05], d’âge [t(31)=3.51, p=0.001] et émotionnelle [t(31)=4.59, p<0.001],et pour la tâche de reconnaissance du genre par comparaison avec les tâches de reconnaissance émotionnelle [t(31)=3.03, p<0.01] et d’âge [t(31)=2.81, p<0.01]. Dans le groupe schizophrénie, les seuls résultats significatifs étaient les temps de réponses plus rapides dans la tâche de reconnaissance du genre par comparaison aux tâches de reconnaissance émotionnelle [t(31)=2.22, p<0.05], d’âge [t(31)=2.61, p<0.05], et d’orientation [t(31)=2.32, p<0.05].
Conclusion : Nos résultats démontrent un déficit généralisé de la reconnaissance faciale dans la schizophrénie. Il semble que le déficit de décodage des expressions faciales émotionnelles (EFE) n’est pas un déficit spécifique, mais est par contre, en, lié à un déficit perceptuel généralisé dans le traitement perceptuel à un niveau inférieur, qui se passe avant l’étape de traitement de décodage émotionnel et qui sous-tend des dysfonctions cognitives plus complexes.
Prix des internes
Identification de marqueurs sociaux et émotionnels associés à l'hallucination acoustico-verbale chez l'enfant et l'adolescent non psychotique
DUMAS L-E., BONNARD-COUTON V., ASKENAZY F.
Hôpitaux pédiatriques de Nice-CHU Lenval, Nice, FRANCE
Introduction : Les hallucinations non psychotiques représentent une symptomatologie non négligeable en pédopsychiatrie. Une telle expérience est très souvent considérée comme un phénomène développemental transitoire et bénin. Malgré tout, les travaux récents recherchent des facteurs de risques d’évolution vers une pathologie psychotique chez ces enfants à l’hallucination « isolée ». La persistance et l’aggravation de l‘expérience hallucinatoire signerait une mauvaise évolution des troubles de l’enfant. Des signes précoces d’apparition et de persistance des hallucinations non psychotiques doivent être recherchés pour ajuster la prise en charge diagnostique et thérapeutique. Décrit comme un évènement cognitif intrusif réactionnel à un mécanisme de défense défaillant face au stress, nous proposons de comparer le profil cognitif et émotionnel des enfants présentant des hallucinations acoustico-verbales non psychotiques, à ceux d’enfants sans hallucinations, afin d’identifier des marqueurs influençant l’apparition et la persistance de ce symptôme.
Méthode : Une étude multicentrique prospective de type cas-témoin, longitudinale sur 6 mois, incluait des patients âgés de 6 à 18 ans, présentant des hallucinations acoustico-verbales sans diagnostic de psychose. La cognition sociale était évaluée à l’aide de la NEPSY II avec les tâches de « théorie de l’esprit » et « reconnaissance des émotions ». Le facteur émotionnel était évalué à l’aide de l’EED IV, pour établir un profil émotionnel de l’enfant, et de la BAVQ-R, catégorisant le vécu de l’enfant face à ses voix. Une analyse statistique des résultats obtenus est en cours de réalisation.
Résultats : L’étude, encore en cours, a inclus 19 cas et 14 témoins. Sur les 11 enfants réévalués à 6 mois, 7 présentent encore des hallucinations et 2 répondent à un diagnostic de psychose. Les patients cas présentent majoritairement des résultats normaux aux tests de théorie de l’esprit et une plus grande difficulté à identifier la tristesse dans la reconnaissance des émotions. Ils ont un profil émotionnel hétérogène et ressentent leurs hallucinations comme toute puissante, malveillantes, luttant activement contre elles. L’appariement cas-témoins ne met actuellement pas en évidence de différence franche.
Conclusion : Les marqueurs de cognition sociale et émotionnel ne semblent pas représenter un facteur de vulnérabilité dans l’apparition et la persistance des hallucinations chez les enfants et les adolescents non psychotiques. Certains enfants continuent de présenter des hallucinations acoustico-verbales à 6 mois sans diagnostic de psychose. Ainsi, sans pouvoir conclure à un modèle psychopathologique, il apparait cependant indispensable de conserver un regard dimensionnel de ce trouble spécifique de l’enfant.
Prix des chefs cliniques, assistants
L'acceptabilité des systèmes d'aide à la décision médicale informatisés en psychiatrie : étude quantitative et qualitative sur une population de psychiatres
BOURLA A.(1), FERRERI F.(1), OGORZELEC L.(2), GUINCHARD C.(2), MOUCHABAC S.(1)
(1) Hôpital Saint-Antoine, paris, FRANCE
(2) Laboratoire de sociologie et d'anthropologie, Université de Franche-Comté, BESANÇON, FRANCE
Introduction : Les récentes découvertes dans le champ de la génétique, de l’imagerie et des biomarqueurs, parallèlement aux évolutions technologiques et au développement de l’informatique médicale, font basculer la médecine dans un nouveau paradigme, celui de la médecine prédictive. Ces nouveaux outils permettent de penser la psychiatrie d’une manière qui pourrait venir bouleverser les pratiques et surtout les praticiens dans leurs croyances, leur éthique et leurs représentations. C’est cette façon de voir qui est interrogée ici, à travers le prisme de l’informatisation, au moyen de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatisé, notamment lorsque ces procédés sont appliqués au champ de la transition vers la maladie ou de la détection précoce de la pathologie. Après avoir rappelé l’état de l’art sur la question (systèmes d’aide au diagnostic, télépsychiatrie, apprentissage automatisé, objet connecté, big data) et réalisé une revue de la littérature, seront décrits les résultats d’une étude venant interroger l’acceptabilité des dispositifs et la « culture de métier » du psychiatre d’un point de vue sociologique.
Objectifs : L’objectif principal est de déterminer l’acceptabilité par les psychiatres des nouveaux systèmes d’aide médicale informatisés en interrogeant plusieurs registres : l’aide au diagnostic psychiatrique, tant en termes de détection de la pathologie qu’en termes de prédictibilité. L’objectif secondaire est d’analyser en quoi cela permet de mieux caractériser la culture de métier de psychiatre.
Matériel et méthode : Il s’agit d’une étude qualitative et quantitative sur questionnaire informatisé (Google-Form®), réalisé en collaboration avec le laboratoire de sociologie de l’université de Franche-Comté et s’adressant à une population de psychiatres et internes en psychiatrie contactés par liste de diffusion ou en réseau. Trois scénarios mettant en scène les dispositifs évalués ont été élaborés comme supports aux questions. Plusieurs méthodes d’analyse statistique ont été employées (Khi-deux, corrélation de Pearson).
Résultats : n = 515 observations ont pu être incluses, les variables sociodémographiques ont été analysées. Sur l’objectif principal : l’acceptabilité globale des systèmes d’aide médicale informatisés est modérée à élevée (75%) mais il existe d’importantes disparités entre les psychiatres révélées par une analyse en sous-groupes. Sur l’objectif secondaire : la culture de métier de psychiatre n’est pas unitaire et plusieurs profils peuvent être distingués.
Conclusion : L’analyse des résultats montre une cohérence entre les profils d’acceptabilité et les profils de culture de métier. Cela permet en appliquant une grille de lecture sociologique de caractériser 4 idéaux-types de psychiatres (« médical », « psychodynamique », « intermédiaire », « interne ») et de les placer dans un « champ » psychiatrique selon une perspective Bourdieusienne.
Prix des start-up en santé mentale

Lucimed
La luminothérapie, un outil naturel et efficace contre la dépression
Mr. Eric DELLOYE, Villers le Bouillet, BELGIQUE
Lucimed est une société belge qui fabrique la Luminette, appareil de luminothérapie qui permet de lutter contre les troubles dépressifs et les troubles circadiens (sommeil, jet-lag, travail posté). La Luminette se présente sous la forme d'une paire de lunettes offrant à son utilisateur la liberté de vaquer à d'autres occupations pendant son traitement de luminothérapie. La Luminette est née en 2006 suite à 4 années de recherche universitaire à Liège en Belgique.