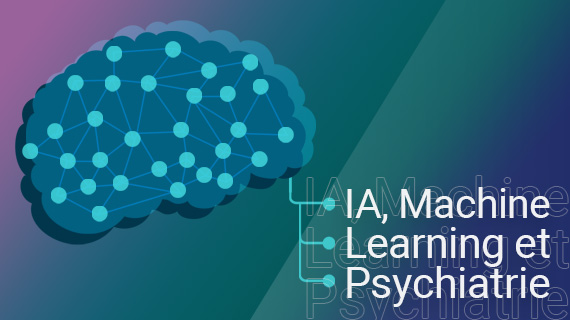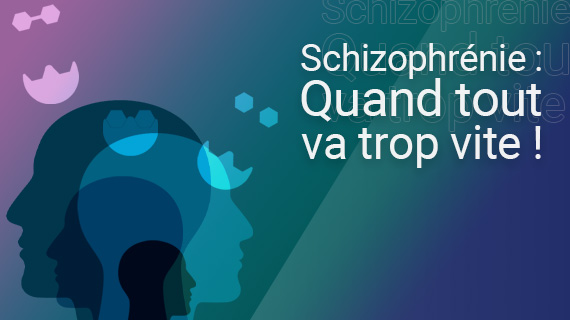Schizophrénie au cinéma : Représentations et actions de déstigmatisation
Auteurs
S. Cervello1, S. Arfeuillère2, A. Caria3
1 Interne en psychiatrie, CHU de Saint-Etienne
2 Chargée de mission
3Directrice, PSYCOM, Paris
Enquête réalisée dans le cadre du DIU «Santé mentale dans la communauté» (Université Lille 2; Université Paris 13; APHM/CHU Sainte-Marguerite; CCOMS, EPSM Lille Métropole)
Résumé
Introduction
La stigmatisation des personnes schizophrènes reste importante dans notre société, et elle est en partie liée aux informations véhiculées par les médias, notamment le cinéma. L’assimilation individuelle de représentations majoritairement négatives est à l’origine du développement de stéréotypes. Lauber et al. (2003) indiquaient que le degré de réalisme perçu était plus déterminant que le taux d’exposition dans le renforcement des attitudes négatives. Nous avons questionné des internes en psychiatrie et des psychiatres sur leur perception des représentations cinématographiques de la schizophrénie et sur différents types d’actions éducatives fondées sur le ciné-débat.
Méthode
Cette enquête descriptive observationnelle transversale réalisée entre juillet et octobre 2016 par auto-questionnaire a permis de recueillir 246 réponses. Il y avait 20 questions dans 3 rubriques : informations générales, représentations de la schizophrénie à l’écran, actions d’enseignement et de sensibilisation.
Résultats
L’échantillon interrogé regroupait plutôt de jeunes professionnels avec une moyenne d’âge de 28,8 ans, plutôt cinéphiles (54.47% voyaient au moins un film par semaine).
39.02% avaient l’impression que la schizophrénie était évoquée dans au moins un film par an et pour 24.39% elle l’était plus fréquemment. Le thriller et le drame, puis le film d’épouvante, étaient les genres les plus associés à la schizophrénie au cinéma.
Pour plus de 80% des répondants elle était fréquemment représentée du côté de la violence et de l’imprévisibilité et/ou confondue avec un trouble dissociatif de l’identité.
Parmi une liste de films, très peu avaient vu Clean, shaven, qui est reconnu et apparaissait comme un des plus fidèles à la réalité. Des films entretenant la confusion avec le trouble dissociatif de l’identité comme Shutter Island, Black Swan ou Fight club étaient très populaires. Un visionnage d’extraits isolait des scènes de Clean, shaven et Pi comme très réalistes, ce qui apparaissait moins pour Un homme d’exception et Birdman. Les extraits les plus réalistes suscitaient surtout des réactions de peur et d’empathie. Le ciné-débat auprès du grand public animé par des professionnels était largement reconnu comme utile, et l’utilisation d’extraits de films de fiction dans l’enseignement intéressait pour dynamiser l’enseignement, discuter de la stigmatisation, ou illustrer des symptômes cliniques.
Conclusion
Ces résultats confirment la perception très négative des professionnels de la schizophrénie au cinéma. En revanche certaines scènes très réalistes et moins connues pourraient être un support pertinent d’enseignement, sur le modèle de la cinemeducation développé aux Etats-Unis. Des actions éducatives à destination du public permettent de discuter des stéréotypes et de favoriser l’information. Le modèle du ciné-débat est appelé à se développer. Y impliquer des usagers de la psychiatrie permettrait des actions de lutte contre la stigmatisation encore plus efficaces.
Le poster
Cliquez sur l'image pour l'agrandir