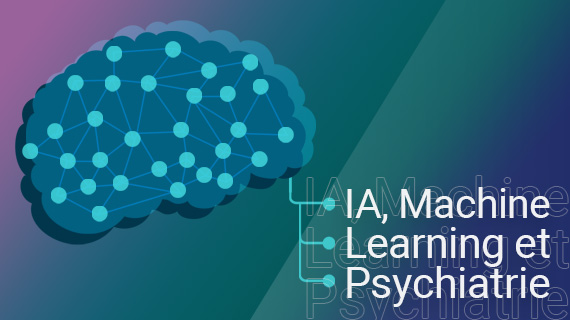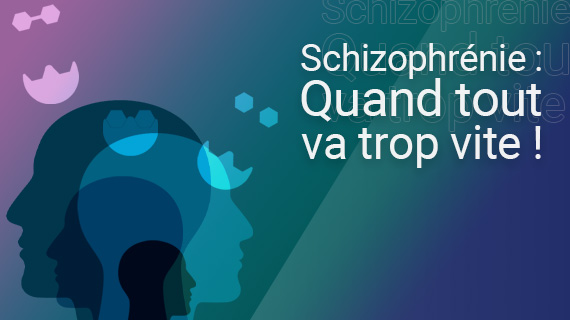Félicitations aux lauréats de l'Encéphale 2018 !

Lors de sa 16e édition, le Congrès de l'Encéphale a décerné 7 prix : découvrez les travaux récompensés !
Prix du Congrès
Efficacité en situation réelle des traitements antipsychotiques dans une cohorte nationale de 29 823 patients
TIIHONEN J.(1), MITTENDORFER-RUTZ E.(1), MAJAK M.(2), SERMON J.(3), TANSKANEN A.(1), TAIPALE H.(1)
(1) Karolinska Institutet, Département des Neurosciences Cliniques, Stockholm SUÈDE
(2) EPID Research Oy, Espoo FINLANDE
(3) Janssen Cilag, Beerse BELGIQUE
Contexte : Il n’est toujours pas clairement établi s’il existe des différences cliniquement significatives entre les traitements antipsychotiques dans la prévention de la rechute de la schizophrénie et ce en raison de l’impossibilité d’inclure de grandes populations de patients dans des essais contrôlés randomisés et en raison des biais de sélection présents dans les études observationnelles. Nous avons cherché à comparer l’efficacité en situation réelle des traitements antipsychotiques dans la schizophrénie.
Méthode : Nous nous sommes appuyés de manière prospective sur des bases de données nationales suédoises pour étudier le risque de ré-hospitalisation et d’échec de traitement au cours de la période 2007-2013 chez tous les patients souffrant de schizophrénie âgés de 16 à 64 ans en 2006 (N = 29 823 dans la cohorte totale ‘prévalente’, N = 4 603 dans la cohorte ‘incidente’ de patients nouvellement diagnostiqués). Des analyses intra-individuelles ont été réalisées pour les analyses primaires dans lesquelles chaque individu a été considéré comme son propre contrôle afin d’éliminer les biais de sélection. La régression multivariée de Cox a été utilisée pour les analyses secondaires. Les critères primaires étaient le risque de ré-hospitalisation et d’échec du traitement (défini comme une ré-hospitalisation psychiatrique, une interruption ou un switch vers d'autres médicaments antipsychotiques, ou le décès).
Résultats : Au cours du suivi, 44 % des patients ont été ré-hospitalisés et 72 % ont présenté un échec du traitement. Le risque de ré-hospitalisation psychiatrique était le plus faible en monothérapie avec une injection de palipéridone de d’action prolongée (AP) (HR 0,51, 95% CI 0,41-0,64), de zuclopenthixol AP (0,53; 0,48-0,57), de clozapine (0,53, 0,48-0,58), de perphénazine AP (0,58; 0,52-0,65), et d’olanzapine AP (0,58; 0,44-0,77) par rapport à l’absence d’antipsychotique. Le flupentixol oral (HR de 0,65; 0,74-1,14), la quétiapine (HR 0,91; 0,83-1,00) et la perphénazine orale (HR 0,86; 0,77-0,97) ont été associés avec le risque le plus important de ré-hospitalisation. Les antipsychotiques AP ont été associés avec un risque de ré-hospitalisation inférieur par rapport à leurs équivalents oraux (0,78; 0,72-0,84 dans la cohorte totale; 0,68; 0,53-0,86 dans la cohorte incidente). La clozapine (0,58; 0,53-0,63) et tous les antipsychotiques AP (HR 0,65 à 0,80) ont été associés avec le plus faible risque d’échec du traitement par rapport au médicament le plus répandu, l’olanzapine orale. Les résultats de plusieurs analyses de sensibilité étaient cohérents avec les analyses primaires.
Conclusions : La clozapine et les antipsychotiques AP sont les traitements pharmacologiques les plus efficaces pour la prévention des rechutes dans la schizophrénie et le risque de ré-hospitalisation est de 20-30 % plus faible avec les antipsychotiques AP par rapport avec les traitements oraux équivalents.
Prix du Comité Scientifique
Anomalies de la conscience et de l'amplification attentionnelle dans la schizophrénie
BERKOVITCH L.(1), DEL CUL A.(2), MAHEU M.(1), DEHAENE S.(1)
(1) Cognitive Neuroimaging Unit, CEA DSV/I2BM, INSERM, Université Paris-Sud, Université Paris-Saclay, NeuroSpin, Gif Sur Yvette, FRANCE
(2) AP-HP, Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière, Service de Psychiatrie d'Adultes, Paris, FRANCE
Introduction : Selon le modèle de la conscience du global workspace de Dehaene et al.(1998), une information devient consciente lorsqu’elle est amplifiée et transmise à des aires cérébrales disséminées grâce à des connexions longue distance, permettant le maintien et la manipulation de l’information au sein d’un réseau de neurones.
Plusieurs études ont montré que les patients schizophrènes présentent des anomalies électives du traitement conscient des informations et du seuil d’accès à la conscience, le traitement subliminal étant préservé. Notre étude cherche à évaluer l’effet de l’amplification attentionnelle sur le seuil de conscience chez les sujets sains et les patients schizophrènes.
Méthode : L’activité cérébrale de 16 sujets sains et de 16 patients schizophrènes a été mesurée en électroencéphalographie dans deux conditions de stimulation visuelle : une condition avec attention et une condition sans attention. Dans la condition avec attention, les participants essayaient de percevoir un chiffre, plus ou moins masqué par des lettres, et dire si celui-ci était supérieur ou inférieur à 5. Il existait quatre délais possibles (SOA : 27, 54, 80 et 160 ms) entre le chiffre présenté et les lettres de façon à étudier différents seuils de perception allant du subliminal au conscient. Dans la condition sans attention, les chiffres étaient toujours présentés mais les participants devaient se concentrer sur des cercles de couleur et évaluer s’il y avait plus de cercles bleus ou jaunes.
Résultats : Les résultats comportementaux confirment l’existence d’une dissociation entre traitement conscient et inconscient chez les patients schizophrènes dans la condition avec attention : leur performance était significativement inférieure à celle des sujets sains lorsque les SOAs étaient longs (80, 160 ms : F1,30 = 11.21, p = 0.002) mais pas lorsqu’ils étaient courts (27, 54 ms : F1,30 = 2.78, p = 0.11).
Dans la condition sans attention l’activité cérébrale était amoindrie, sans différence entre les deux groupes (effet du groupe : p > 0.1 pour toutes les composantes). Les ondes N1 et N2 étaient autant modulées par le SOA dans les deux groupes (p > 0.3 pour toutes les interactions groupe × SOA dans la condition sans attention).
En revanche, dans la condition avec attention, les ondes N1 et P3 étaient fortement réduite chez les patients (effet de groupe pour N1 : F1,105 = 8.76, p = 0.004 ; P3 : F1,105 = 5.64, p = 0.02) et l’onde P3 était moins modulée par le SOA que chez les sujets sains (effet groupe × SOA : F1,105 = 6.33, p < 0.001). L’amplification des ondes P1 et P2 était identique dans les deux groupes (p > 0.5).
Conclusion : Ces résultats montrent que les patients schizophrènes présentent un défaut d’amplification attentionnelle de N1 et P3. La persistance d’une modulation de l’activité cérébrale par le SOA en l’absence d’attention suggère que l’élévation du seuil de conscience observée chez ces patients repose sur des anomalies attentionnelles plutôt que sensorielles.
Prix du e-Poster
Métabolisme du tryptophane et risque suicidaire chez les patients avec épisode dépressif caractérisé
MESSAOUD A.(1), BEN DHIA A.(1), GAHA L.(1), GABRIELLE G.(1), FLAVIA V.(1), STEFANO C.(1)
(1) Hopital Fattouma Bourguiba, Monastir TUNISIE
Introduction : les patients souffrant du trouble dépressif majeur (TDM) présentent une partie majeure de la population à haut risque suicidaire. Plusieurs facteurs sont connus impliqués dans la physiopathologie du TDM et des conduites suicidaires telle la diminution de la neurotransmission sérotoninergique.
Objectif : étudier la variation des concentrations plasmatiques du tryptophane (Trp), sérotonine (5-HT), Kynurenine (Kyn) et du rapport KYN/TRP (indicateur de l’activité enzymatique d’indoleamine-2,3-dioxygenase (IDO)) chez des sujets ayant un TDM et les comparer selon la présence ou l’absence de conduites suicidaires.
Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude cas-témoins incluant 73 patients avec TDM sans conduites suicidaires, 56 patients avec TDM et conduites suicidaires et 40 sujets témoins. Le tryptophane, la sérotonine et le kynurenine ont été dosés par chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC) équipé d'un détecteur fluorométrique pour le tryptophane et la sérotonine et par un détecteur UV pour le kynurenine. Le risque suicidaire a été évalué en utilisant l’échelle d’idéation suicidaire de Beck.
Résultats : la concentration plasmatique moyenne du tryptophane était significativement plus basse chez les patients suicidaires par rapport à ceux non suicidaires (p=0,000) et par rapport aux temoins (p=0,000). De même, la concentration plasmatique de la sérotonine était significativement plus basse chez les patients avec TDM par rapport au temoins (p=0,001). Par contre, le kynurenine ainsi que le rapport KYN/TRP étaient significativement plus élevés chez les patients suicidaires par rapport aux temoins (p=0,008 ; p= 0,000 respectivement).
Conclusion : les résultats de notre étude montrent une "attaque" de la voie de la synthèse de la sérotonine à partir du tryptophane, surtout chez les patients suicidaires, en faveur de celle du kynurenine suite à l’activation de l’IDO.
Prix des internes
Connectivité fonctionnelle cérébrale et trait impulsif : étude par IRMf de repos
MESSAOUD A.(1), BEN DHIA A.(1), GAHA L.(1), GABRIELLE G.(1), FLAVIA V.(1), STEFANO C.(1)
(1) Hopital Fattouma Bourguiba, Monastir, TUNISIE
Introduction : La connectivité fonctionnelle est l’analyse en IRMf de repos -en l’absence de tout stimulus- des oscillations neuronales synchrones dans les ultrabasses fréquences (<0,1 Hz). Il existerait une activité cérébrale intrinsèque, organisée en réseau reflétant les états émotionnels et comportementaux comme la personnalité. L’objectif de notre étude est de démontrer une corrélation entre le score clinique de l’échelle d’impulsivité de Barratt (BIS-10) et des structures fonctionnelles cérébrales, en IRMf de repos.
Méthodes : L’étude incluait tout volontaire indemne de pathologie psychiatrique connue. Chaque participant remplissait la BIS-10 qui évaluait l’impulsivité motrice et cognitive. Une IRMf de repos était effectuée à la suite. L’analyse de la connectivité fonctionnelle s’effectuait par la méthode Multi-Voxel Pattern Analysis (MVPA) adaptée aux régressions multiples avec une variable clinique sans hypothèse sur le réseau impliqué dans la modulation de cette variable. Cela permettait d’observer la force de connectivité entre différents réseaux en fonction de la BIS-10.
Résultats : 74 sujets étaient inclus ; la moyenne d’âge était de 26 ans et 24 volontaires présentaient un trait impulsif. La connectivité entre les structures du réseau du mode par défaut (DMN) était corrélée positivement au trait impulsif (r=0,62,p<0,0001) : plus les éléments du DMN étaient connectés entre eux (connectivité intra-réseau) plus le sujet était impulsif (score de la BIS-10 élevé).
Il existait une corrélation positive entre les structures du réseau sensori-moteur (SMN) et le trait impulsif (r=0,56,p<0,0001) : plus la force de connectivité intra SMN était importante, plus le sujet était impulsif. Il n’existait pas de corrélation négative.
Discussion : Plus la connectivité intra DMN et intra SMN était important, plus le sujet était impulsif. Fonctionnellement, le DMN est activé lorsque le sujet est au repos, centré sur des activités internes (sur Soi, récupération de souvenirs, etc.). Il se désactive lors de tâches cognitives avec une désactivation plus forte lorsque les demandes attentionnelles sont importantes. Il est connu que l’absence de désactivation du DMN est associée à des défauts attentionnels et à une majoration d’erreurs lors de tâches. La plus grande connectivité intra DMN chez les impulsifs expliquerait la difficulté à maintenir leur attention. Le SMN est impliqué dans la coordination entre l’activité motrice et les informations provenant de l’environnementChez le sujet sain, le SMN est sous le contrôle du réseau de contrôle fronto-pariétal. La plus grande connectivité intra SMN chez les impulsifs peut se traduire par un échange accru entre l’environnement et les conséquences comportementales sans aucun contrôle cognitif.
Conclusion : Il existerait des structures fonctionnelles corrélées au trait impulsif. Grâce à cette méthodologie, nous pourrions observer les conséquences fonctionnelles des traitements mis en place pour traiter l’impulsivité.
Prix des chefs de clinique, assistants
Intérêt des isolats génétiques pour la recherche en génétique psychiatrique : une revue de la littérature
SAUVANAUD F.(1)
(1) CHU de Saint-Etienne Hôpital Nord, Saint-Priest-En-Jarez, FRANCE
Introduction : Un isolat génétique est défini comme une population issue d’un groupe fondateur ayant subi un ou des goulots d’étranglement génétiques, suivi(s) d’une expansion en milieu clôt. De par leur homogénéité génétique et environnementale, les isolats génétiques ont déjà permis l’identification de gènes à risque impliqués dans de nombreuses maladies monogéniques à transmission mendélienne, mais également pour les maladies complexes polygéniques. Par ailleurs, la recherche en génétique psychiatrique pour la schizophrénie connait un essor important depuis une décennie, du fait notamment de l’évolution du génie génétique et de la mise en place de très larges cohortes internationales. Dans ce contexte, se pose la question de l’intérêt de l’étude des isolats génétique en génétique psychiatrique. Toutefois, il n’existe pas, à notre connaissance, de revue systématique dans la littérature sur les études génétiques psychiatriques menées sur la schizophrénie dans ces populations.
Méthode : A l’aide d’une revue de la littérature utilisant les mots clés [isolate], [genetics], [psychiatry] et [schizophrenia] sur la base de données Pubmed, nous avons recensé les populations qualifiées d’isolats génétiques ayant fait l’objet de recherches pour la schizophrénie.
Résultats : Nous avons identifié dix isolats génétiques à ancêtre européen et six isolats à ancêtre non européens ayant fait l’objet de publications dans des revues internationales. La majorité de ces cohortes ont fait l’objet d’études de liaison et d’études d’associations. Trois isolats avaient fait l’objet de publication dans des revues de rang A au cours des cinq dernières années. La population Afrikaaner a fait l’objet d’étude par puce d’hybridation génomique comparative (CGHarray) et séquençage exome entier et a permis l’identification de variants rares quantitatifs et qualitatifs, hérités et de novo. De même, une fréquence élevée de variations du nombre de copies de gènes (CNVs) a été retrouvée dans la population Ashkénase. Enfin, la population de l’île de Palau a permis l’étude de la transmission des variants à risque sur trois générations successives et de l’évolution des sujets jeunes à ultra haut risque.
Conclusion : Utilisés dans les études de liaison génétique pour leur homogénéité allélique et la fréquence élevée de larges familles multiplexes, l’étude des isolats génétiques a été délaissée à l’avènement des études d’associations de gène candidats puis génome entier (GWAS), pour lesquels de larges cohortes cas-témoins étaient nécessaires. La recherche de variants rares quantitatifs par CGHarray et qualitatifs par séquençage exome ou génome entier questionne à nouveau l’utilité des populations plus homogènes sur le plan génétique et environnemental.
Prix spécial
Un robot pour diagnostiquer le trouble du spectre de l'autisme ?
GAGNON M.(1), BEAUDOIN A.J.(1), RABY-NAHAS C.(2), MÉRAT Y-M.(2), MICHAUD F.(1), COUTURE M.(1)
(1) Université de Sherbrooke, Sherbrooke, CANADA
(2) Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, Sherbrooke, CANADA
Introduction : Sachant qu’un diagnostic précoce du trouble du spectre de l’autisme (TSA) favorise un meilleur pronostic, une procédure diagnostique efficace permettant d’identifier rapidement ces enfants s’avère nécessaire. Robotiser une partie de l’évaluation pourrait faire ressortir certains comportements difficilement évaluables ou atypiques durant l’évaluation usuelle du TSA. L’objectif de cette étude est donc d’explorer l’utilisation d’un robot-boule interactif afin de différencier les enfants ayant un TSA des enfants au développement neurotypique.
Méthode : Dix-neuf enfants de 2 à 5 ans, soit 9 enfants ayant un TSA et 10 enfants neurotypiques ont participé à une période de jeu standardisé de 10 minutes avec le robot et une évaluatrice. Le langage, les habiletés cognitives, les interactions sociales, les intérêts restreints et répétitifs de même que les comportements stéréotypés ont été comparés.
Résultats : Les deux groupes sont statistiquement similaires pour la prévalence du sexe masculin (p=0,370) et différents pour l’âge (p=0,010) et les habiletés langagières (p=0,009) et cognitives (p=0,003). L’analyse des résultats révèle que les comportements des enfants lors du protocole avec le robot sont statistiquement différents pour les deux groupes en ce qui a trait aux comportements communicatifs (p=0,009) et stéréotypés (p=0,014), l’engagement conjoint avec le robot (p=0,040) et l’évaluateur (p=0,002) ainsi que l’attention conjointe avec l’évaluateur (p=0,011). Les comportements d’automutilation (p=0,474), l’engagement dans la tâche (p=0,375) et la présence de réaction positive au robot (p=1,000) sont quant à eux similaires dans les deux groupes.
Conclusion: Les résultats démontrent que l’utilisation du robot est prometteuse comme outil en soutien diagnostic des enfants ayant un TSA. En effet, on remarque que les enfants neurotypiques et ceux ayant un TSA agissent différemment et positivement lors de l’interaction avec le robot. Les principales différences observées entre les deux groupes sont reliées aux comportements adoptés lors de la communication et du jeu. Par la suite, une étude d’implantation pourrait être effectuée pour évaluer si l’utilisation du robot permet de discriminer les enfants ayant un TSA de ceux présentant d’autres troubles neurodéveloppementaux (ex. : trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité, trouble langagier) ou psychiatriques (ex. : trouble réactionnel de l’attachement).
Prix de l'innovation

Medday Pharmaceuticals
Traiter les maladies du système nerveux en agissant sur le métabolisme cérébral
MedDay est une société pharmaceutique internationale qui cible le métabolisme cérébral pour traiter les maladies du système nerveux. La société a été fondée en 2011 par Frédéric Sedel, MD, PhD et Guillaume Brion, MD. Afin d’identifier de nouvelles cibles thérapeutiques, MedDay explore le métabolisme cérébral sur sa plateforme de recherche qui analyse le liquide céphalo-rachidien (LCR) de patients atteints de diverses affections du système nerveux central.