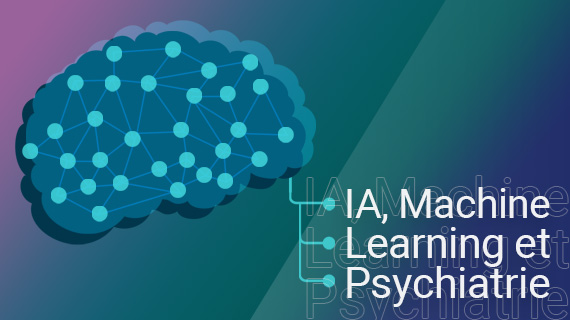Félicitations aux lauréats de l'Encéphale 2020 !
Lors de sa 18e édition, le Congrès de l'Encéphale a décerné 6 prix : découvrez les travaux et la start-up récompensés !

Prix du Congrès
Représentation des femmes intervenant dans les congrès de psychiatrie français
PIERRON J. (1), EL DIRANI E. (5), SANCHEZ S. (4), EL-HAGE W. (3), HINGRAY C. (1,2)
(1) Centre Psychothérapique de Nancy, Laxou, FRANCE;
(2) CHRU, Nancy, FRANCE;
(3) CHRU - Clinique Psychiatrique Universitaire, Tours, FRANCE;
(4) Centre Hospitalier - Pôle IMEP, Troyes, FRANCE;
(5) Université Saint Joseph, Beyrouth, LIBAN

Objectifs : Décrire l’évolution de la représentation des femmes aux deux principaux congrès de psychiatrie en France, le Congrès Français de Psychiatrie et le Congrès de l’Encéphale, de 2009 à 2018, et la comparer à l’évolution de la représentation des femmes parmi les psychiatres français. Secondairement, décrire cette évolution parmi les thèmes de psychiatrie générale, pédopsychiatrie et addictologie aux congrès et la comparer à celle des psychiatres d’adultes, pédopsychiatres et addictologues en France. Décrire également cette évolution au sein des comités d’organisation et scientifique et au sein des symposiums des compagnies pharmaceutiques des congrès.
Méthodes : Les données ont été obtenues par les programmes des congrès de l’Encéphale et du Congrès Français de Psychiatrie de 2009 à 2018 ainsi qu’auprès du Conseil National de l’Ordre des Médecins. La proportion moyenne de femmes aux deux congrès par année a été obtenue en pondérant la moyenne par les différents effectifs des intervenants aux deux congrès. Un test de Chi2 de tendance a été utilisé pour comparer l’évolution de l’écart de proportion au cours du temps.
Résultats : La proportion de femmes parmi les intervenants aux congrès varie de 25% en 2019 à 32% en 2018. Parmi les psychiatres français, la proportion de femmes augmente de 46% à 51%, avec une proportion de femmes supérieure à celle des hommes depuis 2016. La différence de proportion de femmes entre les psychiatres français et les intervenants aux congrès varie entre 21% en 2009 et 17% en 2016, avec une proportion de femmes psychiatres en activité en augmentation (de 46% à 51%) et supérieure pour chaque année à celle des femmes intervenant aux congrès (de 25 à 32%). La proportion de femmes intervenant sur des thèmes de pédopsychiatrie (41-59 %) est supérieure à celles intervenant sur des thèmes de psychiatrie générale (24-33%) et d’addictologie (10-39%). La proportion de femmes est faible dans les symposiums des compagnies pharmaceutiques (7-24%), les membres des comités d’organisation et scientifiques (13-33%) et les présidents de séances (19-28%), bien qu’elle augmente avec le temps.
Perspectives : Cette sous-représentation des femmes dans les congrès de psychiatrie en France pourrait possiblement être améliorée par l’inscription de la question de la parité à la politique des congrès de psychiatrie, parmi les intervenants comme parmi les comités scientifiques et d’organisation.
Prix du Comité Scientifique
BREF est associé à une réduction du fardeau des aidants
REY R. (1,2), LOURIOUX C. (1), VÉHIER A. (1,2), DORION V. (1), D'AMATO T. (1,2), BOHEC A. (1,2)
(1) Centre Hospitalier le Vinatier, Bron - Lyon, FRANCE;
(2) INSERM, U1028; CNRS, UMR5292; Université Lyon 1; Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon, PSYR2 Team, Lyon, FRANCE

Introduction : En psychiatrie, le fardeau des aidants est associé à un excès de morbidité physique et psychique (Mittendorfer, 2018). La psychoéducation (PE) uni ou multifamiliale pour les aidants en psychiatrie présente un bénéfice direct sur la santé de l’aidant et indirect sur celle du proche malade. Chez les proches malades, elle est associée à une réduction du taux de rechutes et de réhospitalisations, ainsi qu’à une meilleure observance thérapeutique (Pharoah, 2010). Chez les aidants, la PE s’accompagne d’une amélioration des connaissances des troubles et des stratégies de coping (Sin, 2013). Les recommandations internationales récentes préconisent que la PE à destination des aidants soit systématique, précoce et intégrée aux soins courants (Galletly, 2016). Afin d’augmenter le recours à la PE en France, des interventions précoces pour les aidants doivent être proposées systématiquement. L’efficacité d’un dispositif de PE précoce pour les aidants nécessite d’être évalué ; seuls 3 essais randomisés contrôlés sont disponibles dans la littérature et aucun n’a été réalisé en France (Bird, 2010). L’objectif de cette étude est d’évaluer l’efficacité du programme BREF, programme PE court et unifamilial, sur la santé des aidants en psychiatrie.
Méthode : BREF est un programme de PE unifamilial, précoce et court (3 séances d’1 heure). Chaque famille est reçue par un binôme de professionnels de santé et un bénévole de l’UNAFAM. Entre octobre 2018 et juillet 2019, 3 centres proposant le programme BREF ont recueilli prospectivement des données socio-démographiques et cliniques (symptomatologie dépressive selon l’échelle CES-D, Center for Epidemiologic Studies - Depression scale) auprès de 108 aidants afin d’évaluer l’efficacité du programme.
Résultats : Avant le programme BREF, 67% des aidants présentent un score CES-D total supérieur au seuil définissant une symptomatologie dépressive significative versus 1,8 à 16,5% des sujets en population générale (Forero DA, 2017). Il existe une corrélation négative significative entre la durée d’évolution des troubles du proche malade et le score CES-D total recueilli en pré-programme (r=-0.420 ; p<0.05) suggérant que la souffrance dépressive est plus importante au cours des premières années d’accompagnement. 41 aidants ont renseigné l’échelle CES-D en pré- et post-programme : on observe une réduction significative du score CES-D total en post-programme (p<0.001 ; score CES-D total moyen ± ET ; pré-programme : 21 ± 10,6 ; post-programme : 15 ± 9,7)
Conclusion : Les données recueillies avant la participation au programme BREF montrent l’impact négatif de la situation d’aidant sur la santé psychique et confirment l’intérêt de proposer précocement des interventions aux aidants, dès la première année d’accompagnement. BREF, programme psychoéducatif unifamilial, précoce et systématique est associé à une réduction significative de la symptomatologie dépressive des aidants au décours immédiat du programme
Prix du Poster
Prise en charge de crise des actes suicidaires et mentalisation
PRADA P. (1), MAGNIN C. (2,3), DEBBANE M. (4), POULET E. (2,3), BESCH V. (4), DUARTE M. (1), GREINER C. (1)
(1) Hôpitaux Universitaires de Genève, Genève, SUISSE;
(2) Hôpital Edouard Herriot, Lyon, FRANCE;
(3) Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon, CH Le Vinatier, Lyon, FRANCE;
(4) Université de Genève, Genève, SUISSE

Les comportements suicidaires sont fréquents et justifient le plus souvent des consultations en urgence ainsi que l’hospitalisation de leurs auteurs. Ces actes sont majoritairement le fait de patients souffrant d’un trouble de personnalité borderline. Leur répétition entraine des ruptures de suivi et une errance dans le système de soins. Un service d’urgence et de crise se trouve à l’interface de la vie quotidienne, des soins ambulatoires et des soins hospitaliers. C'est un lieu privilégié pour détecter les personnes souffrant d’un trouble de personnalité borderline et les aider à s’engager dans un traitement psychothérapeutique ambulatoire aux bénéfices durables. Mais c’est évidemment aussi le lieu privilégié pour faire face aux ruptures et aux crises qui surviennent tout au long du parcours de ces suivis ambulatoires que l’on sait complexes. Dès lors que des soins spécifiques et efficaces existent pour ces patients, il est utile qu’ils soient rendus disponibles aux soignants et aux patients dans ces services. Nous nous proposons dans notre intervention d’exposer un modèle d’intervention de crise qui repose sur les principes de la thérapie basée sur la mentalisation, thérapie qui a démontré son efficacité dans une multiplicité de situations cliniques.
Nous évoquerons les principes théoriques et cliniques qui régissent une intervention de crise basée sur la mentalisation. Ce modèle propose une compréhension du passage à l’acte comme conséquence d'une rupture dans le processus mentalisant. Il permet également de modeler l’intervention du clinicien sur deux axes : proposer au patient une rencontre singulière avec un soignant qui essaye de comprendre ses états mentaux (plutôt qu’il ne les connaît à sa place), travailler à une compréhension commune des éléments affectifs de la crise. Le travail autour du premier axe vise à proposer une validation des affects pour réanimer les capacités de mentalisation et la confiance épistémique. Celui autour du second propose de s’intéresser conjointement aux processus (rupture et réparation de la mentalisation). Cette intervention doit permettre d’aborder la rupture et reprendre (ou entamer) le processus thérapeutique ambulatoire.
Nous montrerons comment articuler ces notions et ces techniques au cours d'une prise en charge hospitalière brève.
Prix des chefs de clinique-assistants
Evaluation des biais attentionnels dans le Trouble de stress post-traumatique
VEERAPA E. (1,2), GANDGENÈVRE P. (1,2), SZAFFARCZYK S. (2), VINNAC B. (2), VAIVA G. (1,2), D'HONDT F. (2)
(1) CHRU de Lille, Hôpital FONTAN, Psychiatrie de l'Adulte, Lille, FRANCE; (2) SCALab UMR CNRS 9193, unité Cure, Hopital Fontan, CHRU de Lille, Lille, FRANCE

Introduction : La chronicisation du trouble de stress post-traumatique (TSPT) serait liée à une altération de la perception des stimuli négatifs. Ce dysfonctionnement se manifesterait sous la forme d'un biais attentionnel (BA). Trois types de BA ont été décrits dans la littérature : la facilitation d’orientation, le défaut de désengagement (ces derniers sont regroupés sous le terme d’hypervigilance) et l’évitement. Aucune étude n'a permis de déterminer lequel de ces trois BA prédomine dans le TSPT. La majorité des études ont employé la Dot-Probe Task (DPT) pour distinguer l’hypervigilance de l’évitement. Lors de la DPT, chaque essai consiste à montrer deux images de chaque côté d’un écran (une négative et une neutre) suivi d’un point, localisé à l’endroit de l’une des deux images précédentes. Le participant doit indiquer le plus rapidement possible la localisation du point. Si sa réponse est plus rapide lorsque le point apparaît du côté de l'image négative que du côté de l'image neutre, on conclut à une hypervigilance face à cette image. Inversement, on conclut à un évitement. Cependant, la DPT ne permet pas de différencier la facilitation d’orientation du défaut de désengagement lorsqu'une hypervigilance est retrouvée. Pour ce faire, notre étude a associé l’oculométrie (technique analysant les mouvements oculaires) à la DPT. Son objectif était double :1) préciser, par cette nouvelle méthode, lequel des trois BA est impliqué dans le TSPT, 2) évaluer si ce BA est lié à un symptôme spécifique du trouble.
Méthode : Trois groupes de 26 participants ont été recrutés : un groupe TSPT, un groupe Trauma sain (composé de sujets ayant vécu un évènement traumatique, sans développer de TSPT) et un groupe Contrôle. Les temps de réponse des participants ont été enregistrés alors qu'ils effectuaient une DPT employant des images de scènes naturelles négatives et neutres. Leurs mouvements oculaires étaient enregistrés de manière concomitante afin d'analyser, d'une part, la direction, la latence et la durée de la première fixation, et d'autre part, le temps total de fixation ainsi que les durées et les nombres moyens de fixations sur les images négatives et neutres.
Résultats : Alors qu'aucune différence significative n'était observée sur les temps de réponse, les résultats principaux concernant les mouvements oculaires indiquaient que l'augmentation du temps de fixation sur les images négatives par rapport aux images neutres était plus importante pour le groupe TSPT (F(2,71) = 4,21 ; p = 0,019 ; η²p = 0,11) par rapport au groupe Trauma sain (t = 2,21, p = 0,056) et au groupe Contrôle (t = 2,72, p = 0,016). En revanche, aucun BA n’était retrouvé à la DPT. Conclusion : Grâce à cette nouvelle méthodologie, les résultats semblent indiquer l'existence d'un défaut de désengagement envers les images négatives en lien avec le TSPT. En clarifiant le type de BA retrouvé, ces résultats ouvrent de nouvelles pistes thérapeutiques sur la prise en charge du TSPT.
Prix des internes
Les effets neuroplastiques de l'électroconvulsivothérapie sont induits par une réduction des taux d'IL-6
BELGE J. (1,2), VAN DIERMEN L. (1), SCHRIJVERS D. (1), SIENAERT P. (2), VANSTEELANDT K. (2), SABBE B. (1), DE TIMARY P. (4), CONSTANT E. (4), VAN EIJNDHOVEN P. (3)
(1) Antwerp University (UA) , Anvers, BELGIQUE;
(2) Katholieke Universiteit Leuven (KUL), Leuven, BELGIQUE;
(3) Radboud University, Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, Nijmegen, PAYS-BAS;
(4) Université Catholique De Louvain, Woluwe Saint-Pierre, BELGIQUE

Introduction : L’électroconvulsivothérapie (ECT) a une puissante fonction immunomodulatrice. Un moyen de combler le fossé entre l'immunomodulation et l'efficacité thérapeutique de l’ECT dans la dépression pourrait être la neuroplasticité induite par l’ECT, car les cytokines pro-inflammatoires telles que les IL-6 et TNFα, ont tendance à diminuer après une cure d’ECT et sont impliquées dans la neurogenèse de l'hippocampe, importante pour l'effet antidépresseur.Méthodes : Nous souhaitions examiner l'effet immunomodulateur de l'ECT et analyser si les changements volumétriques de l'hippocampe chez les patients déprimés traités par l’ECT, sont liés aux changements de taux des IL-6 et TNFα. Les taux plasmatiques des IL-6 et TNFα, ainsi que le volume de l'hippocampe quantifié par IRM, ont été analysés avant et après une cure d’ECT aiguë sur un échantillon total de 62 patients et un sous-échantillon d’IRM de 14 patients. L'humeur a été évaluée une semaine avant et une semaine après l'ECT en utilisant l'Echelle de Dépression de Hamilton.
Résultats : Tous les participants étaient sévèrement déprimés et ont montré une mélioration significative de l'humeur après l’ECT (p < 0.0001). Des baisses importantes des taux d'IL-6 ont été observées (p < 0.05), ainsi qu’une augmentation significative du volume de l'hippocampe (p < 0.001) dans le sous-échantillon d’IRM. Bien qu'aucune corrélation n'ait été trouvée entre les changements d'humeur et les variables inflammatoire et volumétrique, la réduction induite par l'ECT de l'IL-6 périphérique est inversement corrélée à la variation en pourcentage des volumes de l'hippocampe (p <0.01, r=-0.8).
Conclusion : Les résultats montrent que l'ECT a des effets immunomodulateurs, qui semblent être associés à une augmentation volumétrique de l'hippocampe, ce qui suggère que l'effet neuroplastique de l'ECT peut être médié par des processus immunomodulateurs. Toutefois, la pertinence clinique de ce phénomène biologique reste incertaine.
Prix des start-up du Congrès de l'Encéphale
Predictix
Transforming Psychiatric Treatment - Use AI & Machine-Learning Algorithms to Learn from the Trial to Reduce the Errors
Taliaz is a health-tech startup applying science to the world’s data to create digital solutions that better understand brain-related disorders for personalized treatment and management.

Powered by its PREDICTIX AI-health prediction algorithm, our first product, PREDICTIX-Antidepressant, integrates genetic, clinical and demographic data to optimize antidepressant treatment for faster patient recovery.
In addition of using current medication guidelines and literature information, we have applied our pipe-line of algorithms and procedure on the raw data of the Sequence Treatment Alternatives to Relieve Depression (STAR*D) clinical trial, after which an ensemble of machine learning algorithms was applied. A prediction model based on combinations of novel genetic and environmental features was achieved, which yielded results which were significantly higher than current standard of care.
Applying this Scientific-Analytical approach allows us to learn from the trial to reduce the errors, driving a new standard of care in which doctors can make educated decisions when prescribing antidepressant medications to their patients.