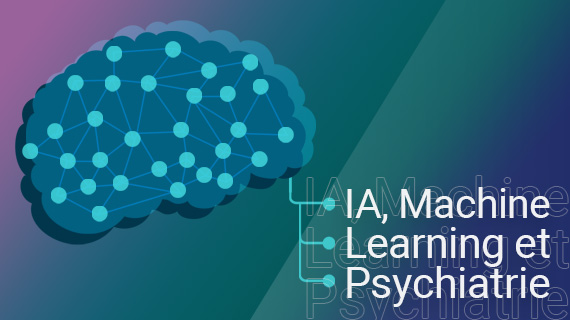Température abdominale et anorexie mentale : marqueur simple de sévérité clinique ?
Auteurs
MASTELLARI T.1, DURIEZ P.2,3
1 Université de Lille, Faculté de Médecine Henri Warembourg, Lille, FRANCE;
2 Clinique des Maladies Mentales et de l’Encéphale, CH Ste Anne, GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, Paris, FRANCE;
3 Institut de Psychiatrie et Neurosciences de Paris, INSERM U1266, Paris, FRANCE
Résumé
Objectifs
L’Anorexie Mentale (AM) est aujourd’hui considérée comme un trouble métabo-psychiatrique. Les dimensions métaboliques et endocriniennes ne doivent plus être considérées comme de simples complications somatiques, mais plutôt comme éléments impliqués dans la physiopathologie. Les études précliniques montrent l’impact de la thermorégulation dans la régulation de l’activité physique en situation de dénutrition et des récentes études cliniques utilisant des caméras thermiques montrent une répartition singulière des températures de surface dans l’AM. Dans ce contexte, les modifications de température corporelle pourraient être un marqueur pertinent du statut métabolique dans l’AM. L’objectif de notre étude est de confirmer par une méthodologie simple et reproductible les résultats obtenus jusque-là en laboratoire et d’étudier le lien entre les modifications de température de surface, le métabolisme de repos et le niveau d’activité physique.
Méthode
Les patients consultant pour la première fois pour AM à la Clinique des Maladies Mentales et de l’Encéphale à Paris ont été inclus dans cette étude. Les températures centrale, abdominale et palmaire ont été mesurées respectivement au niveau auriculaire et cutané grâce à un thermomètre à infrarouges. Des données supplémentaires ont été recueillies, parmi lesquelles la Dépense Énergétique de Repos (DER) par calorimétrie indirecte et le niveau d’activité physique par auto-questionnaire. Des corrélations de Pearson ont été utilisées pour analyser la relation entre les variables.
Résultats
56 patients avec AM, dont 4 de sexe masculin ont été inclus (âge 28.8 ± 10.4 ; IMC = 16 ± 2.2 kg/m2). L’IMC est corrélé positivement avec le ratio température palmaire/centrale (r=0.35 ; p=0.01) et négativement avec le ratio température abdominale/centrale (r=-0.51 ; p=0.00). Ce dernier ratio corrèle négativement avec la DER (r=-0.38, p=0.02) et le niveau d’activité physique mesuré par le Godin Leisure-Time Exercise Questionnaire (GLT) (r=-0.29 ; p=0.04).
Conclusion
Nos données préliminaires confirment pour la première fois de manière simple et écologique l’augmentation de la température de surface abdominale dans l’AM : cette augmentation est expliquée très probablement par la diminution du tissu adipeux sous-cutané, qui agit comme isolant thermique. De plus, ces ratios de température semblent corréler avec des éléments métaboliques et le niveau d’activité physique. Une meilleure caractérisation des modifications de thermorégulation dans l’AM pourrait améliorer le «staging» de sévérité, affiner le suivi de la renutrition et ouvrir de nouvelles perspectives thérapeutiques.
Le poster
Cliquez sur l'image pour l'agrandir