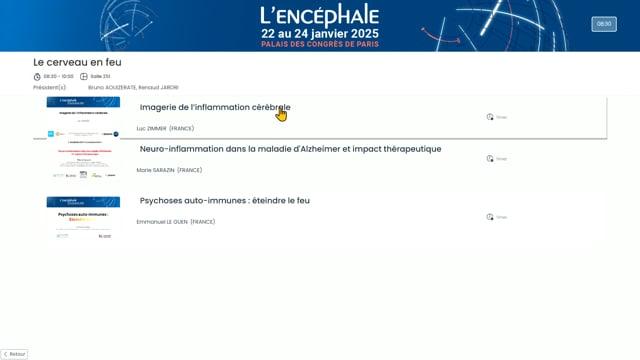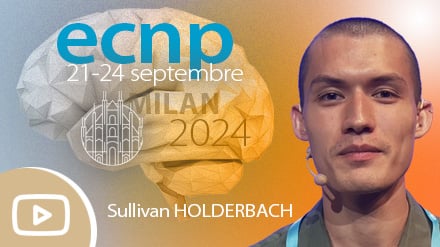Catatonie : comprendre et traiter ce trouble neuropsychiatrique complexe
La catatonie est un trouble neuropsychiatrique grave associé à une morbi-mortalité importante.
Pendant une grande partie du XXe siècle, la catatonie était considérée comme un sous-type de schizophrénie, mais, au cours des dernières décennies, de nouvelles preuves ont montré que la catatonie pouvait survenir dans différentes pathologies, qu’elles soient psychiatriques, neurologiques ou autres.
Cependant, les cliniciens ont de grandes difficultés à reconnaitre les symptômes de catatonie, en faire le diagnostic et proposer une stratégie thérapeutique. Des recommandations ont été élaborées par la British Association for Psychopharmacology pour les accompagner.
Dr Sebastian Walther (Université de Berne, Sisse) et Pr Jonathan Rogers (University College London, Angleterre) animent cette séance éducative, l’occasion de revenir en profondeur sur ce trouble mal maitrisé.
La catatonie est un syndrome psychomoteur comprenant des troubles du comportement moteur (mouvement anormaux et mouvements involontaires), influencés par des états affectifs, possiblement associé à un dysfonctionnement du système autonome. Les épisodes de catatonie peuvent durer de quelques minutes à plusieurs années, bien que le plus souvent ils durent quelques jours. Ils peuvent survenir à tous les âges de la vie, certaines formes très précoces ayant été observées chez des enfants de moins de 5 ans….
Les symptômes de catatonie peuvent être observé à l’œil nu chez nos patients, mais ils sont également à rechercher de manière approfondie lors de l’interrogatoire et de l’examen physique.
Quelques exemples de signes cliniques observables qui doivent vous orienter vers une catatonie : des grimaces, une agitation ou forme de combativité (hausse de l’activité motrice), des prises de postures, un maniérisme ou des stéréotypies (mouvements anormaux), une fixité du regard ou une ambitendance (baisse de l’activité motrice). Lors des interactions avec le patient, il convient de rechercher des verbigérations, une écholalie/échopraxie ou une obéissance automatique, témoins d’une activité anormale, ainsi qu’un mutisme, négativisme ou attitude de retrait, témoins d’une baisse de l’activité. L’examen clinique du patient permet de rechercher une flexibilité cireuse, un oppositionnisme, une obéissance passive, une rigidité, une catalepsie ou un réflexe de préhension (grasping reflex), tous témoins d’une activité anormale.
Le diagnostic est donc clinique, posé lorsqu’au moins 3 symptômes parmi les 12 du DSM5 ou 14 de la CIM 11 sont présents. Le score de Bush-Francis permet le dépistage de la catatonie mais également de coter sa sévérité et de mesurer la réponse aux traitements. En cas de doute, le test au lorazépam reste le meilleur test diagnostic avec une réponse positive dans 80 % des cas de catatonie1.
L’évolution de la catatonie est variable. Il peut s’agir d’un épisode qui débute en quelques heures ou jours et qui dure moins de 4 semaines. La catatonie peut être récurrente lorsque plusieurs épisodes se succèdent après des périodes de rémission. Elle peut également être persistante, avec un début en fin d’adolescence, sans période de rémission, présentant le plus souvent des rituels, un négativisme, des stéréotypies et du maniérisme.
La catatonie peut donc avoir une présentation très hétérogène, avec souvent peu de symptômes visibles, et peut être causée par une diversité de troubles sous-jacents2. Aujourd’hui, on observe que 25 % des personnes présentant une catatonie auront plusieurs épisodes dans leur vie. 20 à 40 % des patients psychotiques auront un épisode de catatonie une fois dans leur vie.
Quelle est l’étiologie de la catatonie ?
On suspecte différentes causes comme un dysfonctionnement du réseau cérébral, une dysrégulation des voies GABA, Glutamate, Dopaminergiques. Les pistes génétiques et inflammatoires sont également envisagées. Nous attendons encore beaucoup de la recherche scientifique pour mieux comprendre. Nous savons aujourd’hui que chez les patients présentant une catatonie et un trouble psychotique, il existe des anomalies du cortex préfrontal et de la substance blanche cortico-spinale ainsi que des dysfonctionnements du réseau moteur rendant le contrôle moteur inefficace dans la catatonie3,4.
L’existence d’une catatonie doit faire rechercher un trouble sous-jacent.
Le plus souvent il s’agit de troubles psychiatriques tels que les troubles psychotiques, dépressifs, maniaques ou l’autisme. Mais dans un tiers des cas, il s’agit de causes médicales5 : encéphalites limbiques, maladies métaboliques, auto-immunes, intoxications aux métaux, justifiant toujours un examen clinique et biologique approfondi et au moindre doute une IRM, une ponction lombaire ou un EEG. Les sevrages sont également source d’épisode catatonique, surtout à l’alcool mais aussi aux benzodiazépines et à la clozapine.
Quelles sont les recommandations en termes de traitement ?
Tout d’abord, la recherche et la prise en charge d’un trouble sous-jacent. Par ailleurs, les complications somatiques de ce trouble (phlébite, déshydratation, escarres, fécalomes, globes vésicaux, infections), particulièrement dans les formes chroniques, sont fréquentes et nécessitent une grande vigilance. Elles doivent être prévenues et prises en charge rapidement.
Le traitement par lorazépam reste la première intention. À débuter à 3-4mg, il permet une titration progressive jusqu’à parfois 20-30mg si nécessaire, tout en maintenant une vigilance sur l’état de conscience du patient et ses capacités respiratoires. Le traitement à maintenir tant que le trouble sous-jacent n’est pas totalement pris en charge. Lors de la résolution de l’épisode catatonique, l’arrêt du lorazépam, se fait après une diminution très lentement progressive sur plusieurs semaines.
L’ECT peut être nécessaire en alternative au lorazépam, en cas de catatonie maligne, ou en cas d’urgence ou de résistance au traitement.
Il existe quelques pistes en cas de résistance au traitement mais qui restent très minoritaires. La carbamazépine dans les cas de troubles de l’humeur sous-jacent, le valproate dans des cas de catatonie agitée. L’usage des antipsychotiques doit rester très prudent. Ils peuvent être nécessaires pour traiter une cause psychiatrique sous-jacente mais certains auteurs recommandent de les éviter du fait du risque élevé de syndrome malin des neuroleptiques associé à la catatonie.
Même si les mécanismes physiopathologiques sous-jacents sont loin d’être élucidés, une approche clinique approfondie permet toutefois de diagnostiquer ce syndrome, de le prendre en charge et d’éviter ainsi une morbi-mortalité évitable.
Pour plus d’info : https://www.ucl.ac.uk/mental-health/research/catatonia
Références :
- Taylor and Fink, 2003, Fink et al. 2009, Sienaert et al, 2014
- Rogers et al. 2023 Psychol Med
- Viher et al. 2020 Schizophrenia Research
- Walther et al. 2024 Schizophrenia Research
- Oldham 2018 Psychosomatics
Dr Odile Amiot, psychiatre, Boulogne-Billancourt
Compte rendu d'une session présentée lors de l'ECNP (European College of Neuropsychopharmacology), Milan 21-24 septembre 2024
Avec le soutien institutionnel de Lundbeck

Attention cette publication est un compte-rendu de congrès qui peut contenir des informations hors autorisation de mise sur le marché