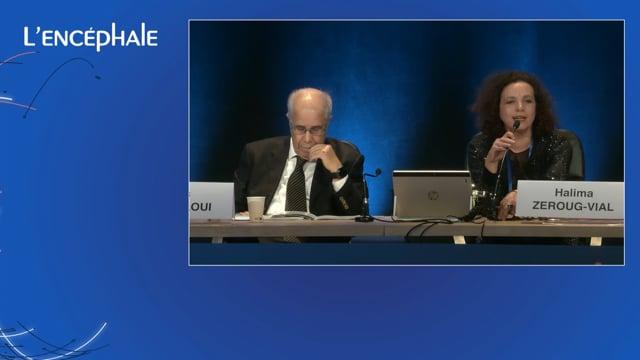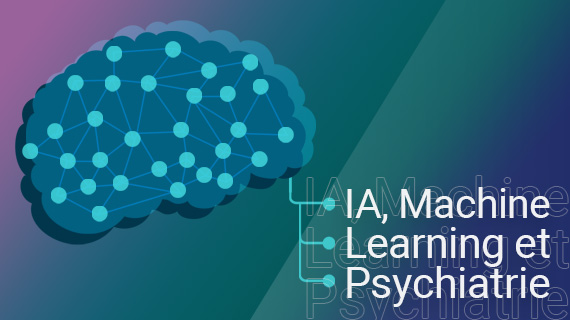Psychiatrie de précision : vers une mise en œuvre clinique
Ce symposium propose une vue d'ensemble des opportunités et des défis liés à la mise en œuvre de la psychiatrie de précision.
La psychiatrie de précision vise à modifier le paysage clinique et de recherche par la mise en œuvre de modèles de prédiction individualisés. Ces modèles sont développés et validés à des fins de dépistage, de pronostic, de diagnostic ou de stratification thérapeutique au niveau de l'individu (médecine de précision) ou du sous-groupe (médecine stratifiée).
La médecine de précision ou la médecine stratifiée utilisant ces modèles peut servir à identifier les personnes atteintes ou à risque d'un trouble, à prédire leurs résultats cliniques et à éclairer les stratégies de traitement (par exemple, les traitements tels que les médicaments, les interventions psychologiques et/ou la stimulation cérébrale, en délivrance simple ou combinée), améliorant ainsi le rapport coût-efficacité. Cet aspect est crucial compte tenu des coûts cliniques et socio-économiques considérables associés aux troubles psychiatriques. En effet, non seulement les troubles psychiatriques ont une prévalence cumulée élevée tout au long de la vie (jusqu'à 30 % dans la population générale) mais, de surcroit, ces troubles ont pour la majorité, une apparition précoce, généralement à l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Enfin la trajectoire de ces troubles couvre une partie conséquente de la vie entière, beaucoup de personnes atteintes rencontrant une évolution chronique et invalidante.
Cette psychiatrie de précision a connu au cours des dernières années un essor considérable, qui a été rendu possible par plusieurs évolutions de la médecine :
- Le développement des technologies modernes de suivi numérique, réalisant un soutien à la médecine de précision avec des stratégies centrées sur la personne et des mesures en continu/en temps réel de l'activité et du comportement quotidiens.
- L’intégration de données multimodales (prédiction multimodale, à l'aide de données omiques, d'imagerie cérébrale et de données phénotypiques intégrées).
Cependant, plusieurs obstacles, tant méthodologiques qu'éthiques, peuvent entraver la mise en œuvre de la psychiatrie de précision dans les soins ou en limiter la valeur.
Un des champs dans lesquels la psychiatrie de précision a accumulé de nombreux travaux est celui de l’intervention précoce dans les troubles psychotiques. D’une manière plus générale, le modèle de l’intervention précoce peut être assimilé à la question de la prévention en psychiatrie et interroge les liens entre psychiatrie et santé mentale1,2.
Ainsi, l’état à haut risque (sous-entendu à haut risque de psychose) décrit un état avec un niveau de symptômes modérés, calqués sur ceux retrouvés dans les états psychotiques (symptômes délirants, troubles perceptifs, troubles cognitifs) mais n’ayant pas atteint un seuil d’intensité ou de durée suffisant pour être qualifié de symptômes caractéristiques. Il existe fréquemment un retentissement psycho social3. Bien qu’entièrement conçu en référence à la symptomatologie de la schizophrénie, c’est-à-dire établi comme un état « pré-psychotique » ou prodromique, il est intéressant de constater qu’une partie minime de ces personnes qualifiées à haut risque évolueront vers une schizophrénie. La majorité des sujets développant des pathologies psychiatriques autres seront indemnes de troubles psychiatriques4. L’enjeu est donc de pouvoir correctement repérer ces personnes et, une fois identifiées, parvenir à déterminer le risque individuel d’évolution. De nombreux programmes d’identification précoce existent, s’appuyant sur des campagnes de sensibilisation, des créations de site web,... Lors du symposium, un nouveau type de programme est présenté, reposant sur un système de dépistage numérique. L'étude ENTER, menée par une équipe de chercheurs du King's College de Londres et de l'Université de Glasgow, utilise un modèle prospectif-observationnel pour étudier la relation entre la détection numérique auto-administrée et les évaluations cliniques5.
Une autre piste présentée, incorporant là aussi des innovations technologiques, consiste en l’utilisation de nouvelles méthodes d'exploration de données. Ainsi, le traitement du langage naturel sur les dossiers médicaux informatisés permettrait de détecter parmi les individus déjà connu des services de psychiatrie, ceux à risque de développer un trouble psychotique6. Cette méthode semble encore plus fiable dès lors que les observations à plusieurs moments du suivi (méthode « dynamique ») sont pris en compte7. Cette piste peut s’appliquer en soins secondaires (psychiatrie) mais également en soins primaires en combinant les informations de différentes bases de données de santé (étude DETECT [Dynamic ElecTronic hEalth reCord deTection]8).
Enfin, la dernière direction présentée, concernant plus spécifiquement la prédiction du devenir des sujets, est l’intégration de plusieurs niveaux d’exploration (exploration multi-échelle), omiques, imagerie, clinique. Un exemple d’étude en cours dans ce champ est l’étude ProNET (Psychosis Risk Outcomes Network)9.
À noter que pour le seul niveau de l’imagerie, des publications très récentes relancent l’intérêt de cette modalité dans la psychiatrie de précision, que ce soit dans le domaine de la psychose10,11 comme de la dépression12.
Associer cette modalité d’imagerie à d’autres explorations, en particulier génétique et neuropsychologique, semble constituer une voie très prometteuse, à l’instar de l’exemple donné par les travaux effectués dans la maladie d’Alzheimer13.
Une limitation de taille concernant ces travaux, est que si les modèles de détection et de prédiction sont foison, il semblerait que seulement une partie ridiculement faible (0,2 %) soit réellement implémentée14. Ainsi, une orientation intéressante, est d’intégrer ces données multi-échelles par le biais d’une interopérabilité des bases de données de santé, afin de fournir une plateforme facilement utilisable par le praticien pouvant le renseigner sur les risques et le pronostic de son patient15. Une perspective attirante mais qui n’est pas sans poser des problèmes éthiques et de confidentialité des données.
Pr Éric Fakra, psychiatre, Saint-Étienne
Références :
- Fusar-Poli P, Hijazi Z, Stahl D, Steyerberg EW. The Science of Prognosis in Psychiatry: A Review. JAMA Psychiatry. 2018;75(12):1289-1297. doi: 10.1001/jamapsychiatry.2018.2530.
- Fusar-Poli P, Correll CU, Arango C, Berk M, Patel V, Ioannidis JPA. Preventive psychiatry: a blueprint for improving the mental health of young people. World Psychiatry. 2021;20(2):200-221. doi: 10.1002/wps.20869.
- Fusar-Poli P, Borgwardt S, Bechdolf A, Addington J, Riecher-Rössler A, Schultze-Lutter F, Keshavan M, Wood S, Ruhrmann S, Seidman LJ, Valmaggia L, Cannon T, Velthorst E, De Haan L, Cornblatt B, Bonoldi I, Birchwood M, McGlashan T, Carpenter W, McGorry P, Klosterkötter J, McGuire P, Yung A. The psychosis high-risk state: a comprehensive state-of-the-art review. JAMA Psychiatry. 2013 Jan;70(1):107-20. doi: 10.1001/jamapsychiatry.2013.269.
- Lin A, Wood SJ, Nelson B, Brewer WJ, Spiliotacopoulos D, Bruxner A, Broussard C, Pantelis C, Yung AR. Neurocognitive predictors of functional outcome two to 13 years after identification as ultra-high risk for psychosis. Schizophr Res. 2011;132(1):1-7. doi: 10.1016/j.schres.2011.06.014.
- https://youngspace.org/our-research/e-detection-tool-for-emerging-mental-disorders-enter-study
- Irving J, Patel R, Oliver D, Colling C, Pritchard M, Broadbent M, Baldwin H, Stahl D, Stewart R, Fusar-Poli P. Using Natural Language Processing on Electronic Health Records to Enhance Detection and Prediction of Psychosis Risk. Schizophr Bull. 2021;47(2):405-414. doi: 10.1093/schbul/sbaa126.
- Krakowski K, Oliver D, Arribas M, Stahl D, Fusar-Poli P. Dynamic and Transdiagnostic Risk Calculator Based on Natural Language Processing for the Prediction of Psychosis in Secondary Mental Health Care: Development and Internal-External Validation Cohort Study. Biol Psychiatry. 2024;96(7):604-614. doi: 10.1016/j.biopsych.2024.05.022.
- Raket LL, Jaskolowski J, Kinon BJ, Brasen JC, Jönsson L, Wehnert A, Fusar-Poli P. Dynamic ElecTronic hEalth reCord deTection (DETECT) of individuals at risk of a first episode of psychosis: a case-control development and validation study. Lancet Digit Health. 2020;2(5):e229-e239. doi: 10.1016/S2589-7500(20)30024-8.
- https://pathprogram.ucsf.edu/ProNET
- Ward HB, Beermann A, Xie J, Yildiz G, Felix KM, Addington J, Bearden CE, Cadenhead K, Cannon TD, Cornblatt B, Keshavan M, Mathalon D, Perkins DO, Seidman L, Stone WS, Tsuang MT, Walker EF, Woods S, Coleman MJ, Bouix S, Holt DJ, Öngür D, Breier A, Shenton ME, Heckers S, Halko MA, Lewandowski KE, Brady RO Jr. Robust Brain Correlates of Cognitive Performance in Psychosis and Its Prodrome. Biol Psychiatry. 2024:S0006-3223(24)01460-4. doi: 10.1016/j.biopsych.2024.07.012. Epub ahead of print.
- Koutsouleris N et al.; International FTD-Genetics Consortium (IFGC), the German Frontotemporal Lobar Degeneration (FTLD) Consortium, and the PRONIA Consortium. Exploring Links Between Psychosis and Frontotemporal Dementia Using Multimodal Machine Learning: Dementia Praecox Revisited. JAMA Psychiatry. 2022;79(9):907-919. doi: 10.1001/jamapsychiatry.2022.2075.
- Lynch CJ, Elbau IG, Ng T, Ayaz A, Zhu S, Wolk D, Manfredi N, Johnson M, Chang M, Chou J, Summerville I, Ho C, Lueckel M, Bukhari H, Buchanan D, Victoria LW, Solomonov N, Goldwaser E, Moia S, Caballero-Gaudes C, Downar J, Vila-Rodriguez F, Daskalakis ZJ, Blumberger DM, Kay K, Aloysi A, Gordon EM, Bhati MT, Williams N, Power JD, Zebley B, Grosenick L, Gunning FM, Liston C. Frontostriatal salience network expansion in individuals in depression. Nature. 2024;633(8030):624-633. doi: 10.1038/s41586-024-07805-2.
- Reas ET, Shadrin A, Frei O, Motazedi E, McEvoy L, Bahrami S, van der Meer D, Makowski C, Loughnan R, Wang X, Broce I, Banks SJ, Fominykh V, Cheng W, Holland D, Smeland OB, Seibert T, Selbaek G, Brewer JB, Fan CC, Andreassen OA, Dale AM; Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative. Improved multimodal prediction of progression from MCI to Alzheimer's disease combining genetics with quantitative brain MRI and cognitive measures. Alzheimers Dement. 2023;19(11):5151-5158. doi: 10.1002/alz.13112.
- Salazar de Pablo G, Studerus E, Vaquerizo-Serrano J, Irving J, Catalan A, Oliver D, Baldwin H, Danese A, Fazel S, Steyerberg EW, Stahl D, Fusar-Poli P. Implementing Precision Psychiatry: A Systematic Review of Individualized Prediction Models for Clinical Practice. Schizophr Bull. 2021 16;47(2):284-297. doi: 10.1093/schbul/sbaa120.
- Koch E, Pardiñas AF, O'Connell KS, Selvaggi P, Camacho Collados J, Babic A, Marshall SE, Van der Eycken E, Angulo C, Lu Y, Sullivan PF, Dale AM, Molden E, Posthuma D, White N, Schubert A, Djurovic S, Heimer H, Stefánsson H, Stefánsson K, Werge T, Sønderby I, O'Donovan MC, Walters JTR, Milani L, Andreassen OA. How Real-World Data Can Facilitate the Development of Precision Medicine Treatment in Psychiatry. Biol Psychiatry. 2024;96(7):543-551. doi: 10.1016/j.biopsych.2024.01.001.
Compte rendu d'une session présentée lors de l'ECNP (European College of Neuropsychopharmacology), Milan 21-24 septembre 2024
Avec le soutien institutionnel de Lundbeck

Attention cette publication est un compte-rendu de congrès qui peut contenir des informations hors autorisation de mise sur le marché