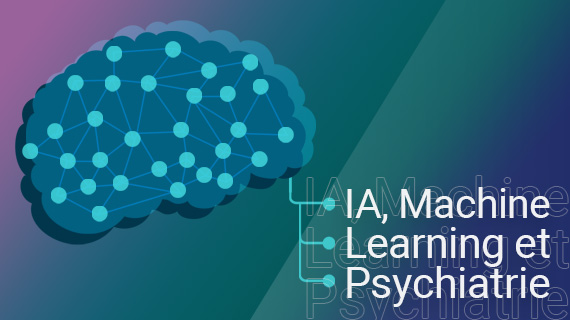Troubles cognitifs associés à la schizophrénie : une perspective de traitement pharmacologique ?
Cognitive impairment in schizophrenia: a potential pharmacological treatment?
La schizophrénie est un trouble psychiatrique d’étiologie multifactorielle qui touche environ 24 millions de personnes, soit une sur 300, dans le monde selon l’Organisation Mondiale de la Santé. Ce trouble se manifeste cliniquement par des symptômes positifs comme les hallucinations et les délires, par des symptômes négatifs tels que l’émoussement affectif et le retrait social et par des symptômes cognitifs.
Les déficits cognitifs peuvent être présents avant même le premier épisode psychotique mais une augmentation de ces déficits est souvent observée une fois que le trouble schizophrénique a débuté. Ces troubles cognitifs sont sous-tendus par des mécanismes physiopathologiques associés à la schizophrénie et ne peuvent être uniquement expliqués par la présence de symptômes négatifs ou par les effets indésirables des traitements antipsychotiques [1]. Ils sont associés au pronostic fonctionnel et à la qualité de vie de l’individu [2].
Les traitements antipsychotiques et les approches psychothérapeutiques n’ont démontré qu’un effet de faible amplitude sur les performances cognitives des patients [3]. Seules, la remédiation cognitive et dans une moindre mesure l’activité physique régulière ont montré une amélioration ou une compensation des déficits cognitifs [4]. Il n’existe pas à ce jour de traitement pharmacologique approuvé dans la prise en charge des troubles cognitifs associés à la schizophrénie.
Le dysfonctionnement de la neurotransmission glutamatergique médiée par les récepteurs N-méthyl-D-aspartate (NMDA) apparait impliqué dans les causes des troubles cognitifs associés à la schizophrénie [5]. Ainsi, l’amélioration de la transmission glutamatergique par l’augmentation des niveaux synaptiques de glycine, un co-agoniste des récepteurs NMDA, a été étudiée chez les patients atteints de schizophrénie. Les inhibiteurs du transporteur 1 de la glycine (GlyT1) augmenteraient les niveaux synaptiques de glycine et, par conséquent, la neurotransmission glutamatergique et les processus de neuroplasticité en aval. Ils représentent donc une stratégie thérapeutique d’intérêt pour la prise en charge des troubles cognitifs associés à la schizophrénie [6].
Dans ce contexte, l’efficacité et la tolérance de l’iclepertine (composé BI 425809), un inhibiteur sélectif de GlyT1, ayant montré une augmentation de la glycine extracellulaire dans le liquide céphalorachidien de rongeurs et de volontaires sains [7], a été étudié chez des patients souffrant de schizophrénie sur 12 semaines [8].
Cet essai de phase 2, contrôlé par placebo, en double aveugle a ainsi randomisé 509 patients stabilisés d’âge adulte dans 5 groupes : iclepertine 2 mg (n=85), iclepertine 5 mg (n=84), iclepertine 10 mg (n=85), iclepertine 25 mg (n=85) et placebo (n=170) [8]. Le critère de jugement principal était basé sur l’évolution d’un score composite (T-score) à la MATRICS Consensus Cognitive Battery (MCCB). Cinq des 6 modèles dose-réponse (méthode MCPMod) ont montré un bénéfice statistiquement significatif de l’iclepertine par rapport au placebo à 12 semaines (linear [t=2∙55, p=0∙015], linear in log [t=2∙56, p=0∙015]; Emax [t=2∙75, p=0∙0089], sigmoid Emax [t=2∙98, p=0∙0038], logistic [t=2∙77, p=0∙0085]). Les améliorations des fonctions cognitives les plus importantes par rapport au placebo ont été observées pour les groupes recevant une posologie de 10 mg et 25 mg.
L’iclepertine était globalement bien toléré. La fréquence des événements indésirables était similaire entre les différents groupes de traitement, et aucune relation dose-effet n'a été observée.
Ces résultats prometteurs contrastent avec ceux de précédents essais cliniques dans le traitement des troubles cognitifs associés à la schizophrénie ayant étudié des agonistes au récepteur nicotinique α-7 à l'acétylcholine [9,10], un antagoniste au récepteur H3 histaminergique [11], un inhibiteur de la phosphodiestérase 9 [12] ou d’autres molécules glutamatergiques telles que la bitopertine. La différence tient peut-être à la cible, mais aussi à la méthodologie. D’autres études sont en cours, associant remédiation cognitive et pharmacothérapie, ce qui est novateur plutôt que de se résigner au schisme qui trop souvent encore sépare ces deux approches au lieu de les rendre complémentaires voire synergiques.
Les résultats positifs associés à l’iclepertine seront à confirmer sur de plus larges effectifs. Plusieurs études de phase 3 (CONNEX) sont ainsi en cours [13], afin d’étudier l’efficacité et la tolérance dans des plus grandes populations de patients souffrant de schizophrénie.
Par Ludovic Samalin1
1 - Department of Psychiatry, CHU Clermont-Ferrand, University of Clermont Auvergne, CNRS, Clermont Auvergne INP, Institut Pascal (UMR 6602), Clermont-Ferrand, France
Références
- McCutcheon RA, Keefe RSE, McGuire PK. Cognitive impairment in schizophrenia: aetiology, pathophysiology, and treatment. Mol Psychiatry 2023;28(5):1902-18. https://doi.org/10.1038/s41380-023-01949-9.
- Galderisi S, Rossi A, Rocca P, Bertolino A, Mucci A, Bucci P, et al. The influence of illness-related variables, personal resources and context-related factors on real-life functioning of people with schizophrenia. World Psychiatry 2014;13(3):275-87. https://doi.org/10.1002/wps.20167.
- Nielsen RE, Levander S, Kjaersdam Telléus G, Jensen SO, Østergaard Christensen T, Leucht S. Second-generation antipsychotic effect on cognition in patients with schizophrenia : a meta-analysis of randomized clinical trials. Acta Psychiatr Scand 2015;131(3):185-96. https://doi.org/10.1111/acps.12374.
- Vita A, Gaebel W, Mucci A, Sachs G, Barlati S, Giordano GM, et al. European Psychiatric Association guidance on treatment of cognitive impairment in schizophrenia. Eur Psychiatry 2022;65(1):e57. https://doi.org/10.1192/j.eurpsy.2022.2315.
- Dauvermann MR, Lee G, Dawson N. Glutamatergic regulation of cognition and functional brain connectivity: insights from pharmacological, genetic and translational schizophrenia research. Br J Pharmacol 2017;174: 3136–60. https://doi.org/10.1111/bph.13919
- Balu DT, Coyle JT. The NMDA receptor 'glycine modulatory site' in schizophrenia: D-serine, glycine, and beyond. Curr Opin Pharmacol 2015;20:109-15. https://doi.org/10.1016/j.coph.2014.12.004.
- Rosenbrock H, Desch M, Kleiner O, Dorner-Ciossek C, Schmid B, Keller S, Schlecker C, et al. Evaluation of Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of BI 425809, a Novel GlyT1 Inhibitor: Translational Studies. Clin Transl Sci 2018;11(6):616-23. https://doi.org/10.1111/cts.12578.
- Fleischhacker WW, Podhorna J, Gröschl M, Hake S, Zhao Y, Huang S, et al. Efficacy and safety of the novel glycine transporter inhibitor BI 425809 once daily in patients with schizophrenia: a double-blind, randomised, placebo-controlled phase 2 study. Lancet Psychiatry 2021;8(3):191-201. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30513-7.
- Haig GM, Bain EE, Robieson WZ, Baker JD, Othman AA. A Randomized Trial to Assess the Efficacy and Safety of ABT-126, a Selective α7 Nicotinic Acetylcholine Receptor Agonist, in the Treatment of Cognitive Impairment in Schizophrenia. Am J Psychiatry 2016;173(8):827-35. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2015.15010093.
- Walling D, Marder SR, Kane J, Fleischhacker WW, Keefe RS, Hosford DA, et al. Phase 2 Trial of an Alpha-7 Nicotinic Receptor Agonist (TC-5619) in Negative and Cognitive Symptoms of Schizophrenia. Schizophr Bull 2016;42(2):335-43. https://doi.org/10.1093/schbul/sbv072.
- Haig GM, Bain E, Robieson W, Othman AA, Baker J, Lenz RA. Evaluation of the Efficacy, Safety, and Tolerability of BI 409306, a Novel A randomized trial of the efficacy and safety of the H3 antagonist ABT-288 in cognitive impairment associated with schizophrenia. Schizophr Bull 2014;40(6):1433-42. https://doi.org/10.1093/schbul/sbt240.
- Brown D, Nakagome K, Cordes J, Brenner R, Gründer G, Keefe RSE, et al. Phosphodiesterase 9 Inhibitor, in Cognitive Impairment in Schizophrenia: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Phase II Trial. Schizophr Bull 2019;45(2):350-59. https://doi.org/10.1093/schbul/sby049.
- Rosenbrock H, Desch M, Wunderlich G. Development of the novel GlyT1 inhibitor, iclepertin (BI 425809), for the treatment of cognitive impairment associated with schizophrenia. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2023;273(7):1557-66. https://doi.org/10.1007/s00406-023-01576-z.
Avec le soutien institutionnel de Boehringer-Ingelheim