Félicitations aux lauréats de l'Encéphale 2025 !
À l'occasion de sa 23e édition, le Congrès de l'Encéphale a décerné plusieurs prix : découvrez les travaux et start-up récompensés !
Prix du congrès
Prix du comité scientifique
Prévalence des comorbidités psychiatriques chez les usagers de drogues français
MOULIS L. (1,2), MICHEL L. (3), NAGOT N. (1,2), LACOSTE J. (5), ROLLAND B. (4), DONNADIEU H. (2)
(1) Unité de Recherche Clinique et Epidémiologique, CHU Montpellier, Univ Montpellier, Montpellier, FRANCE; (2) PCCEI, Univ Montpellier, INSERM, EFS, Univ Antilles, Montpellier, FRANCE; (3) CESP Inserm UMRS 1018, Centre Pierre Nicole, univ Paris Saclay, Croix Rouge Française, Paris, FRANCE; (4) Service Universitaire d'Addictologie de Lyon (SUAL), Lyon, FRANCE; (5) CHU de Martinique Site P-Zobda Quitman, Fort-De-France, FRANCE
Introduction
La co-occurrence de comorbidités psychiatriques chez les individus souffrant de troubles liés à l’usage de substances, communément appelée pathologie duelle, pourrait atteindre 40 à 50 %. Cependant, ces chiffres sont largement basés sur des données provenant d’individus consultant dans les centres de traitement des addictions, fournissant une représentation potentiellement biaisée de la situation. Par conséquent, cette étude visait à réaliser un dépistage communautaire des comorbidités psychiatriques chez les individus qui consomment activement des substances psychoactives, afin d’obtenir une compréhension plus précise de leurs troubles psychiques.
Méthode
Cette étude transversale de prévalence a examiné la santé mentale des utilisateurs actifs de drogues dans plusieurs villes françaises (Paris, Lyon et Marseille). Tous les adultes déclarant utiliser des substances psychoactives (au-delà de l’alcool, tabac et cannabis) étaient éligibles. Le recrutement des participants était effectué via une méthode d’échantillonnage dirigé par les répondants (RDS) permettant d’atteindre des population difficiles d’accès. Cette technique repose sur la sélection initiale de participants, les « graines », qui recrutent ensuite d’autres participants de leur réseau en utilisant des coupons afin d’aboutir à un échantillon représentatif de la population cible. Les participants ont été accueillis, informés, inclus, interrogés et dépistés par des pairs employés pour l’étude. Un processus de dépistage en deux étapes a été utilisé : un questionnaire de dépistage rapide en 9 questions (QST), suivi pour les participants QST-positifs de trois modules du MINI, hétéro-administrés par un professionnel de santé formé.
Résultats
Le QST a été administré à 2 515 personnes. L’âge moyen des participants était de 44 ans et la majorité étaient des hommes (84 %). Leur niveau de précarité était relativement important avec un mode de vie permanent pour à peine la moitié d’entre eux et aucune assurance maladie pour presqu’un tiers. La cocaïne et/ou le crack étaient présents chez la majorité des participants. Entre 51 % et 61 % des participants avaient un questionnaire QST positif selon les villes. Globalement, 16% [14%-18%] des participants avaient un épisode dépressif majeur (EDC), 29% [27%-32%] avaient un risque suicidaire présent, et 10% [8%-11%] avaient des troubles psychotiques selon les modules du MINI (Figure 1). 35% [33%-37%] de la population avt au moins un des trois troubles.
Conclusion
Les résultats de ce dépistage communautaire chez les usagers actifs de drogue montrent une prévalence élevée et préoccupante de troubles psychiatriques parmi cette population, soulignant la nécessité de stratégies de prévention, de traitement et de soutien plus efficaces. En adoptant une approche plus inclusive et plus communautaire, cette étude contribue à une meilleure compréhension de la santé mentale des usagers de drogue habituellement difficiles à atteindre.
Prix du Poster
Formation identitaire chez individus avec trouble de personnalité borderline entre 16 et 25 ans
MUNGO A. (1), DELHAYE M. (4), BLONDIAU C. (2), HEIN M. (3)
(1) CH Le Domaine - ULB, Braine L'alleud, BELGIQUE; (2) Hôpital universitaire de Bruxelles - site Erasme, Bruxelles, BELGIQUE; (3) CHU Brugmann, Bruxelles, BELGIQUE; (4) CHU HELORA - Hôpital de Jolimont, La Louvière, BELGIQUE
Introduction
La perturbation de l'identité est une des caractéristiques clé du trouble de la personnalité borderline (TPB), caractérisée par des troubles de l'image de soi. Cette étude visait à utiliser l'échelle « Dimensions of Identity Development Scale « (DIDS) dans une population âgée entre 16 et 25 ans, afin d'évaluer les différences de statut identitaire et les corrélations avec les caractéristiques du TPB ainsi que l'existence éventuelle d'une corrélation entre les caractéristiques du TPB, les scores obtenus à la DIDS et les scores des différentes dimensions de ce trouble.
Méthode
Nous avons analysé les données de 132 individus : 44 atteints de TPB confirmés par le passage d’un entretien semi-structuré le « Diagnostic Interview for Borderline—Revised » (DIB-R). Les analyses statistiques comprenaient un test de régression quantile pour déterminer les différences dans la DIDS après ajustement des facteurs de confusion identifiés lors des comparaisons de groupes et des tests de corrélation de Spearman entre la DIDS, les caractéristiques du TPB et le DIB-R.
Résultats
Les résultats ont indiqué des scores à la DIDS significativement plus bas dans le groupe TPB, notamment dans la prise d’engagement, l'exploration en surface, l'identification à l’engagement et l'exploration ruminative. Après ajustement, seule l'exploration en surface diffère significativement entre les deux groupes. Toutes les dimensions de la DIDS sauf l'exploration en profondeur sont corrélées avec les caractéristiques du TPB. Des corrélations significatives ont pu également être démontrées entre la dimension cognitive et l'exploration en profondeur, entre le score total de la DIDS et le nombre de tentatives de suicide et entre l'identification à l’engagement et le nombre de TS.
Conlusion
Notre échantillon clinique a montré une formation identitaire distincte par rapport aux témoins, avec une exploration en surface plus faible associée au TPB. L'exploration ruminative est corrélée au TPB, suggérant que les individus s'engagent dans des processus exploratoires répétitifs. Les TS étaient négativement associés au développement identitaire global et à l'engagement, indiquant que les comportements impulsifs du TPB se croisent avec les difficultés identitaires.
Prix des internes
Identification d'un handicap par les personnes vivant avec une dépression
MEBAZAA C. (1,2), THIBOUT B. (1), ROTHARMEL M. (3), GROS K. (4), BULTEAU S. (5), CHEVANCE A. (1,2)
(1) Université de Paris Cité, CRESS, INSERM UMR 1153, Paris, FRANCE; (2) Hôpital Hôtel Dieu, Centre d′Épidémiologie Clinique, AP-HP, , Paris, FRANCE; (3) Normandie Univ, UNICAEN, Inserm U1237, PhIND, Neuropresage team, GIP Cyceron, 14000 Caen, France; Centre Hospitalier du Rouvray, Service Hospitalo-Universitaire de Psychiatrie, Centre Thérapeutique d'Excellence, 76300 Sotteville-lès-Rouen, France; Fédérat, 76300 Sotteville-Lès-Rouen, FRANCE; (4) Université Paris-Est Créteil - Faculté de Santé, Département des Sciences humaines et sociales en Santé, , Créteil, FRANCE; (5) U1246 SPHERE, University of Nantes, University of Tours, INSERM, Nantes, France; CHU Nantes, Department of Addictology and Psychiatry, , Nantes, FRANCE
Introduction
La dépression touche 6 à 10 % de la population mondiale. Le Global Burden of Disease la classe comme la deuxième cause d'années vécues avec une incapacité. Cette mesure repose sur la perception subjective des manifestations cliniques par la population générale. Il est nécessaire d'étudier le point de vue des personnes ayant une expérience vécue sur le handicap associé à la dépression, en tenant compte de trois dimensions : interaction avec le contexte, auto-identification en tant que personne en situation de handicap, et accès à un statut administratif pour la dépression.
Méthodes
Étude transversale menée au sein de l'e-cohorte francophone ComPaRe Dépression, avec 3956 personnes ayant déclaré un épisode dépressif majeur. Les participants étaient des adultes en dépression active ou en rémission. Les données sociodémographiques et cliniques, ainsi que les résultats sur l'incapacité (WHODAS 2.0), ont été recueillis via la cohorte et un questionnaire supplémentaire. Le résultat principal reposait sur trois questions fermées couvrant les trois dimensions du handicap : 1) les difficultés attribuées à la dépression sont-elles perçues comme handicapantes ? 2) les participants s'identifient-ils comme personnes en situation de handicap ? 3) souhaitent-ils une reconnaissance administrative ? Une question ouverte permettait de recueillir les raisons liées à l'identification du handicap. Les caractéristiques descriptives et les résultats ont été présentés avec des statistiques descriptives. Une analyse qualitative thématique a été réalisée pour le résultat secondaire.
Résultats
En mai 2024, 1442 participants francophones ont été inclus, dont 52,6 % (759/1442) étaient en dépression active, avec un score moyen d'incapacité de 51,8 % (WHODAS 2.0), et 47,4 % (683/1442) en rémission avec un score de 37,0 %. Au total, 76,0 % (1 096/1442) ont identifié un handicap lié à la dépression, 51,9 % (749/1442) se sont identifiés comme des personnes en situation de handicap, et 43,6 % (629/1442) ont obtenu ou souhaiteraient obtenir une reconnaissance administrative. L'analyse thématique a identifié 387 raisons, regroupées en 38 catégories.
Conclusion
Les personnes ayant vécu la dépression rapportent des niveaux élevés de handicap, mesurés selon des normes épidémiologiques et cliniques. Une majorité reconnaît la dépression comme une source de handicap, mais seulement la moitié s’identifie comme en situation de handicap, et encore moins demandent une reconnaissance administrative. Ces résultats invitent à repenser la mesure du handicap et à adapter la pratique clinique, en tenant compte des dimensions situationnelle, identificatoire et statutaire
Prix des chefs de clinique assistants
La santé mentale et les stratégies de coping chez les étudiants en médecine marocains : Étude transversale
JAAFARI M. (1), AALOUANE R. (2), RAMMOUZ I. (3)
(1) faculté de médecine et de pharmacie de guelmim, Guelmim, MAROC; (2) Service universitaire de Psychiatrie , centre hospitalier hassan2 , Fès, MAROC; (3) laboratoire des neurosciences , faculté de la médecine et de pharmacie à Agadir, Agadir, MAROC
Introduction
Au Maroc, les études médicales font partie des études supérieurs les plus longues et difficiles. De nombreuses études ont montré que les étudiants en médecine souffrent beaucoup de détresse psychologique . Les objectifs de notre étude sont d’estimer la prévalence de cette détresse psychologique, et identifier les stratégies d’adaptation (coping) face au stress.
Méthodes
Il s’agit d’une étude transversale réalisée auprès de 632 étudiants (entre 3éme et 6éme année) à la faculté de médecine de Fès. Le questionnaire comporte une partie sociodémographique, le GHQ12 qui évalue la détresse psychique, et une partie qui exploite la gestion du stress.
Résultats
L’âge moyen de l'échantillon était de 22,28 ans +/- 1,690 avec une prédominance du sexe féminin (62,50%). La moyenne du score de GHQ-12 était de 5,00+/-
3,613. Plus de la moitié de nos étudiants (50,60%) avaient une détresse psychologique. 61,10% des étudiants utilisaient de façon répétée des options de gestion du stress. 59,20% des étudiants avaient signalé le besoin d’une aide psychologique. La moyenne des scores de GHQ-12 était significativement élevée chez les étudiantes (sexe féminin), et chez les étudiants qui utilisent les différentes différents moyens de gestion de stress.
Conclusion
Les résultats retrouvés chez nos étudiants sont très alarmants, des interventions auprès d’eux sont bien nécessaires.
Prix des start-up en santé mentale
Prix du public : EOS





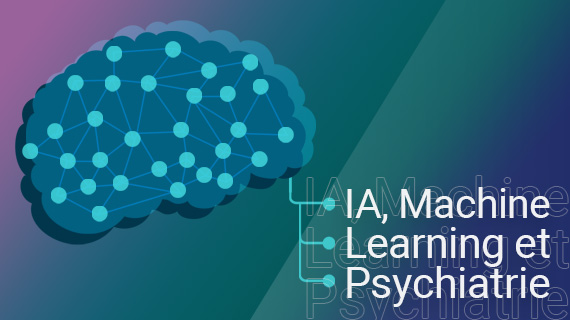
Plainte cognitive inversement associée à la transition psychotique chez les ARMS
HAMDAN-DUMONT M. (1), HABERT M. (1), COUTURAS J. (1), CALVET B. (1)
(1) Centre Hospitalier Esquirol, Limoges, FRANCE
Introduction
Les structures d'intervention précoce (IP) sont de plus en plus nombreuses en France. À Limoges, une équipe dédiée à l'évaluation et à la prise en charge des jeunes présentant un Ultra-Haut Risque (UHR) de psychose a vu le jour en 2019. Lors des trois premières années, l'adressage des patients se faisait principalement par les services de psychiatrie.
Méthodes
Il s'agit d'une étude de cohorte rétrospective. L'inclusion dans l'étude correspondait à la date d'évaluation par la CAARMS (Comprehensive Assessment of At-Risk Mental States), outil de stadification le plus répandu et dont la version française a été validée en 2014.
Les déterminants cliniques étudiés étaient la quantification des contenus inhabituels de la pensée (CIP) et des anomalies perceptives (AP) (absents/légers/sévères), la présence de symptômes dépressifs, les plaintes cognitives subjectives (PCS), la consommation active de tétrahydrocannabinol, le maintien d'une activité scolaire ou professionnelle, les antécédents familiaux de psychose (AFP), et l'orientation par la psychiatrie d'adulte ou la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent au moment de l'évaluation initiale.
La transition psychotique était surveillée sur une durée de 6 mois post-évaluation. Une courbe de survie utilisant la méthode Kaplan-Meier a été appliquée, et une comparaison a été effectuée avec un test log-rank. Les analyses des déterminants en sous-groupe ont été faites grâce à une régression logistique pas à pas ascendante.
Une valeur p <0,05 était considérée comme statistiquement significative.
Résultats
Ont été inclus 37 sujets sans symptômes psychotiques et 39 UHR; 13 UHR (35,2 %) ont présenté une transition psychotique, versus aucun du groupe sans symptômes psychotiques, ce qui constituait une différence significative lors de l'analyse de survie à 6 mois (log-rank p < 0,001).
Les plaintes cognitives subjectives lors de l'évaluation initiale étaient inversement associées à la transition OR 0.13 95 % IC [0.03-0.64]. La variable CIP était associée à la transition psychotique OR 8,57 95 % IC [1,17-63].
Conclusion
Malgré une taille d'échantillon modeste, le facteur plainte cognitive subjective s'est révélé comme étant un facteur protecteur de la transition psychotique chez les UHR étudiés.
Il serait intéressant de recueillir cette variable lors de l'évaluation initiale, et de la comparer aux altérations quantifiées par les bilans neuropsychologiques. D'autres études, et notamment prospectives, devraient s'intéresser à ce facteur.