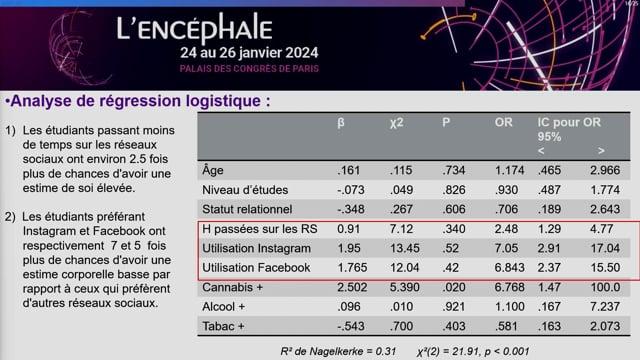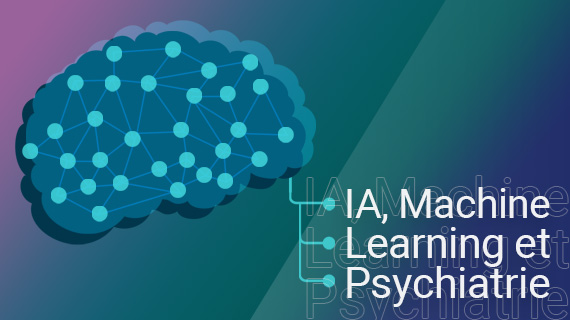Editorial : Covid et santé mentale, ou l’amour au temps du choléra ?
En laissant mes pensées vagabonder sur le titre de ce dossier thématique, Covid et santé mentale, je repense à L’amour au temps du choléra, le magnifique roman de Gabriel García Márquez. Il y est pourtant bien peu question du choléra, si ce n’est pour donner ses lettres de noblesse à Juvenal Urbino, médecin et époux légitime de Fermina, avant que de l’intérieur les « sortilèges de l’habitude » ne consomment leur mariage. Il se peut que la question des liens entre Covid et santé mentale n’ait d’ailleurs que peu de liens avec la Covid elle-même, comme le choléra est pour García Márquez le prétexte, au sens premier, de cette histoire d’amour contrariée l’espace d’un demi-siècle.
Les conséquences directes de la Covid-19 ont certes un intérêt en psychiatrie, au travers du neurotropisme du SARS-Cov-2 d’une part et surtout des désordres inflammatoires qu’il engendre. L’histoire n’est pas tant celle d’un virus, que celle, désormais classique, d’une réponse inflammatoire disproportionnée. Et c’est ainsi que nous retrouvons le serpent de mer des liens entre inflammation et troubles psychiatriques, ponctués notamment par le prix Nobel de Julius Wagner-Jauregg sur l’impaludation dans la neurosyphilis en 1927.
Mais ce sont les conséquences sociales de la crise sanitaire qui interrogent le plus les psychiatres. Les soignants, en premier rempart, paient leur tribut à cette grande cause, au travers du stress post-traumatique qui a toujours accompagné les hommes de retour du front. L’incertitude sur la maladie elle-même et l’état de siège dans laquelle elle nous précipite nous exposent aux fièvres obsidionales des villes assiégées. Plus encore, l’incertitude sur l’emploi et sur les conséquences à court, moyen et long terme de la crise économique et sociale rencontre les lignes de faille des individus et de la société qu’ils composent. La rupture du lien social au gré de la distanciation physique, dont il faut absolument redire qu’elle n’est que malgré nous distanciation sociale, parachève cet ébranlement de notre appareil psychique.
Est-il question de santé mentale ou de psychiatrie ? A vrai dire la question n’a d’importance que si la première, la santé mentale, prétend se substituer à la seconde, la psychiatrie. Ce serait oublier une fois de plus les maladies mentales et les patients qui en souffrent. Pour autant, il faut rappeler que l’exercice de la psychiatrie passe par l’absence de hiérarchie entre les souffrances. C’est parce qu’elle n’est pas subordonnée à une norme sociale, ou d’ailleurs à quelque réalité « objective » que ce soit, qu’une souffrance peut être entendue et soignée en psychiatrie. Dans cette crise sanitaire et sociale tâchons d’exercer notre art conformément à ce souci de l’autre.
Raphaël Gaillard
Président du Comité Scientifique du Congrès de l’Encéphale
Ce contenu vous est proposé avec le soutien institutionnel de Janssen