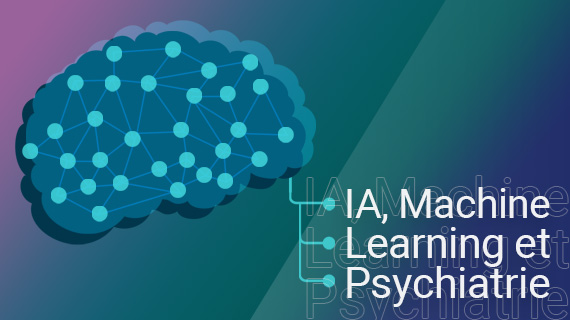Les enfants par temps de Covid
Lors du premier confinement, les enfants sont restés à la maison, considérés comme vecteurs potentiels du Covid-19. Les enfants atteints de handicap se sont aussi vus confinés, une grande partie des structures d’accueil ayant fermé.
De premières études américaines et européennes ont mis en évidence une augmentation des signes de détresse chez les parents et plus de difficultés psychiques chez les adultes ayant des enfants de moins de 16 ans que chez les autres. La présence des enfants au domicile perçue comme un frein au télétravail a sans doute amené à la décision de réouverture des écoles au second confinement.
L’impact de l’épidémie sur les adultes n’aurait-elle pas éclipsé son impact sur les enfants eux-mêmes ? Eric Acquaviva et Richard Delorme, pédopsychiatres à l’hôpital Robert-Debré à Paris, s’alarment (1). Un quart des enfants a présenté des signes de détresse : peur de la mort d’un proche, troubles du sommeil, manque d’appétit, fatigue chronique, cauchemars ; 4 % des enfants ont décroché de l’école lors du premier confinement.
Selon l’OCDE, cette détresse est encore plus marquée chez les enfants vulnérables ou issus de familles démunies. Plusieurs études retrouvent une augmentation des idées suicidaires chez les jeunes, particulièrement touchés par la déprivation sociale.
Les violences ont atteint des sommets, qu’elles aient lieu dans le cadre familial (+60 % d’appels urgents au 119 (2)) ou sur le web entre pairs, notamment le harcèlement à caractère xénophobe vis-à-vis de personnes issues de la communauté asiatique (un collégien sur deux selon une étude américaine (3)).
Préparer le monde d’après est donc plus que jamais protéger la jeunesse, et s’assurer que celle-ci ne soit pas la variable d’ajustement du bouleversement de la vie des adultes.
Lucie Berkovitch
Cheffe de clinique au GHU Psychiatrie et Neurosciences
Tout le dossier Covid et santé mentale
Bibliographie
- « A l’heure où le déconfinement se profile, qu’en disent les enfants ? Leurs voix semblent inaudibles… »
- Enfance en danger : le gouvernement mobilisé
- STOP AAPI HATE YOUTH REPORT, Russell Jeung et al.
Ce contenu vous est proposé avec le soutien institutionnel de Janssen