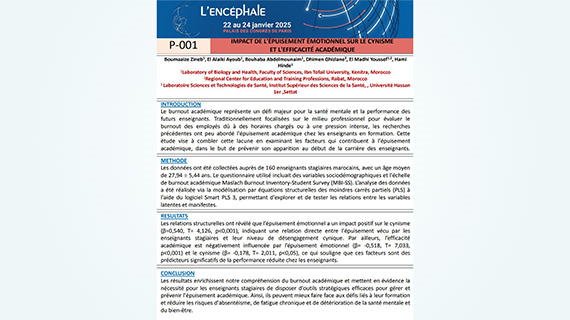Comment définir le burnout ?
L’évolution des conditions et des organisations de travail est associée à une prévalence croissante des risques psychosociaux susceptibles de porter atteinte à la fois à la santé physique et la santé mentale1. Le syndrome d’épuisement professionnel, équivalent en français du terme anglais burnout, se traduit par un « épuisement physique, émotionnel et mental » qui résulte d’un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel.
Il correspond à la dernière étape d’un stress chronique et prolongé au travail2.
Dans la lignée des travaux de Christina Maslach3, il est souvent réduit à trois dimensions1 :
- L’épuisement émotionnel (dimension prédominante)
- La dépersonnalisation (ou déshumanisation de la relation à l’autre avec un cynisme vis-à-vis du travail)
- La réduction de l’accomplissement personnel au travail
L’épuisement émotionnel est un état de fatigue psychologique caractérisé par une absence quasi-totale d’énergie émotionnelle2 qui se répercute sur la vitalité de l’individu. Cette composante représente la dimension « stress » du burnout. La dépersonnalisation se manifeste par une attitude négative et détachée de la part de l’individu envers les personnes avec qui il interagit dans son contexte professionnel (collègues, clients, usagers, patients etc.) qui finissent par être traités tels des objets. C’est la dimension « interpersonnelle » du burnout. Dans la réduction de l’accomplissement personnel au travail, l’individu va porter un regard particulièrement négatif et dévalorisant sur la plupart de ses réalisations, il est démotivé avec une baisse de son estime de soi. Cela correspond à la dimension d’« autoévaluation » du burnout.
De nombreux questionnaires servent à repérer les phénomènes de dégradation du rapport subjectif au travail1. Le Maslach Burnout Inventory (MBI), mis au point en 1981 est l’outil scientifiquement validé le plus utilisé aujourd’hui4. Il peut être un dispositif de médiation pour guider un entretien avec le patient.
Dr Éric HENSGEN
Centre Hospitalier Rouffach
Retour au dossier spécial burnout
Références
- HAS. Fiche mémo « Repérage et prise en charge cliniques du syndrome d’épuisement professionnel ou burn-out ». Mars 2017.
- Legeron P. Dépression, burn-out et risques psychosociaux. Fondation Pierre Deniker. Article N°29.
- Maslach C., “Burned-Out,” Human Behavior, Vol. 5, No. 9, 1976, pp. 16-22.
- Maslach C. "Understanding Burnout: Definition issues in analysing a complex phenomenon". In : Paine WS Ed. Job stress and burnout. Beverly Hills (California). Sage Publications, 1982.
Ce contenu vous est proposé avec le soutien institutionnel de Lundbeck