Félicitations aux lauréats de l'Encéphale 2022 !
À l'occasion de sa 20e édition, le Congrès de l'Encéphale a décerné plusieurs prix : découvrez les travaux et start-up récompensés !
Prix du Congrès
Prix du Comité Scientifique
CO3-2 La prévalence et les facteurs associés à la dépression, l'anxiété, et le PTSD chez les professionnels de santé du secteur public : étude nationale multicentrique
OUAZZANI HOUSNI TOUHAMI Y. (1), MAIOUAK M. (2), OMARI M. (1), BOUT A. (1), OTHEMAN Y. (1), AARAB C. (1)
(1) Service de Psychiatrie, CHU Hassan II , Fès, Maroc;
(2) Service d'épidémiologie, CHU Hassan II , Fès, Maroc
Introduction : La pandémie COVID-19 confronte les professionnels de la santé à des défis sans précédent, ce qui pourrait impacter leur santé mentale
Objectif : Evaluer la prévalence de la dépression, l’anxiété, et l’état de stress post traumatique chez les professionnels de santé du secteur public au Maroc pendant cette pandémie, et leurs facteurs associées.
Méthode : C’est une enquête transversale à visée descriptive et analytique menée le mois de juin 2020 auprès de 1535 professionnel de santé exerçant dans 24 centres hospitaliers de toutes les régions du Maroc.
On a exclu les professionnels de santé du secteur libéral. Les données étaient recueillies à l’aide d’un auto-questionnaire en ligne et anonyme, diffusé aléatoirement à travers les comptes professionnels de messagerie des professionnels de santé. On a eu recours à trois échelles : Le PHQ-9 (Patient Health Questionnaire-9) pour mesurer la dépression et son intensité, le GAD-7 (Generalized Anxiety Disorder-7) pour évaluer l’anxiété généralisée, et le PCL-5 (PTSD Check List for DSM5) pour mesurer le PTSD.
La valeur p ≤ 0,05 a été considérée comme significative dans l’analyse univariée. On a utilisé le modèle de régression logistique dans l’analyse multivariée. On a eu recours au logiciel statistique SPSS 17.0.
Résultats : Le taux de participation était de de 59 % (2600 professionnels de santé contactés). L’échantillon total comprenait 1267 médecins et 268 infirmiers. L’âge moyen était de 30,70 ± 5,94, le sexe féminin représentait 59,2% (N=908) avec un sexe ratio H/F= 0,69. Les professionnels de santé impliqués directement dans la prise en charge COVID représentaient 58,3% (N=896).
Les taux de prévalence étaient de 33,2% (N=511) pour la dépression, 25,1 % (N=385) pour l’anxiété généralisée, et 23,1% (N=354) pour le PTSD. Un total de 658 (42,8%) participants avaient au moins l’un des trois troubles psychiatriques.
Dans l’analyse multivariée, la régression logistique a montré que la présence d’une maladie physique chronique, les antécédents psychiatriques familiaux, l’exercice dans un hôpital non universitaire, la perception modérée et élevée du stress étaient des facteurs de risque de la dépression chez les professionnels de santé. La catégorie des infirmiers était un facteur de risque indépendant de la dépression et le PTSD. Le sexe féminin était significativement associé à l’anxiété. Les professionnels de santé habitant avec un membre de la famille ayant une maladie chronique avait significativement un risque élevé de PTSD. Un sentiment de sécurité vis-à-vis du risque de contamination et une perception diminuée du danger étaient des facteurs protecteurs de la dépression, l’anxiété, et le PTSD.
Conclusion : Le stress lié à la pandémie de COVID-19 est un facteur majeur générant des réponses émotionnelles et cognitives importantes qui impactent la santé mentale des professionnels de santé du secteur publique.
Prix du E-poster
(P-156) Evaluation des psychothérapies - rapport Inserm (2004) : pourquoi une telle controverse ?
DURPOIX A. (1)
(1) Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Strasbourg, France
Introduction : Le rapport de l’Inserm Psychothérapies – trois approches évaluées (2004) retrouvait que les TCC et les thérapies familiales étaient validées scientifiquement dans une majorité des troubles psychiatriques, alors que la psychanalyse était validée uniquement dans le trouble de personnalité limite. Une vive controverse médiatique éclata obligeant le ministre de la santé de l’époque à désavouer publiquement ce rapport et à le retirer du site du ministère sans contrexpertise, ce qui n’était encore jamais arrivé dans l’histoire de l’Inserm. Pour tenter de comprendre les raisons d’une intervention aussi directe du politique dans une controverse scientifique, nous nous sommes donc intéressés à analyser philosophiquement les critiques médiatiques de ce rapport1.
Méthode : Nous avons récolté les articles médiatiques évoquant ce rapport grâce au moteur de recherche Europress avec les mots-clés « TEXT= inserm & 2004 ». Nous avons ensuite analysé ces critiques sous un angle épistémologique, historique et sociologique. Pour cette analyse, nous avons été aidés par des travaux universitaires reconnus, comme ceux de Frank Sulloway, Annick Ohayon, Mikkel Borch-Jacobsen, Carl Schorske, Adolf Grünbaum.
Résultats : 6996 articles correspondaient aux mots-clés, 46 articles médiatiques évoquaient le rapport en question (35% dans Le Monde, 17% dans Libération, 9% dans Le Figaro, <7% pour les autres journaux), dont 26 étaient critiques. Sur le plan épistémologique, les critiques étaient liées à un dualisme franc séparant le corps et l’esprit (exemple : « la souffrance psychique n’est ni évaluable ni mesurable », « par définition le psychisme échappe à de telles évaluations »), à une vision politisée des sciences (ex : « action de marketing », « résultats électoraux », « motivations idéologiques »), à une vision pessimiste de la santé mentale (ex : « on n’arrive pas à admettre qu’en matière de santé mentale, le pourcentage de guérison est faible ») et à une vision postmoderniste/relativiste (ex : « évaluer tue »). Sur le plan historique, les critiques évoquaient le traumatisme de la seconde guerre mondiale (ex : « au lieu de brûler aujourd’hui les livres de Freud, les nouveaux barbares invoquent la science »), l’assimilation historique de la psychanalyse à la philosophie humaniste (ex : « Va-t-on poursuivre une politique qui nous éloigne de la tradition humaniste de l’Europe ») et l’influence du communisme (ex : « forte mobilisation de la gauche unie »). Enfin, sur le plan sociologique, le manque de moyens en psychiatrie a joué un rôle (ex : « dénigrer le rapport de l’Inserm, c’était le prix à payer pour que les plus contestataires de la profession ne polémiquent pas sur le plan santé mentale »).
Conclusion : De multiple facteurs interagissent et expliquent le rejet de ce rapport. Ces dernières années, ce rapport tend néanmoins à être réhabilité avec la montée des neurosciences et les critiques de la psychanalyse (ex : Sophie Robert).
Prix des Internes
(CO4-7 ) Prévalence de l'utilisation et de la dépendance aux benzodiazépines au Liban
DAGHER R. (1), GHAYAD T. (1), RICHA S. (1)
(1) Faculté de Médecine - Université Saint Joseph de Beyrouth, Beyrouth, Liban
Introduction : La consommation de benzodiazépines reste un problème de santé publique d’actualité. L’objectif était d’évaluer la prévalence et identifier d’éventuels facteurs de risque de la consommation et du trouble de l’usage des benzodiazépines au Liban.
Méthodes : Une enquête a été menée auprès de 802 individus résidant au Liban. L’échantillon a été constitué via la diffusion d’un questionnaire en ligne par le biais des réseaux sociaux. Ce questionnaire a divisé l’échantillon en deux groupes : le premier non-consommateur et le second consommateur. Le second groupe, consommateur, a répondu également au « Benzodiazepine Dependence Questionnaire », un questionnaire validé pour le dépistage de la dépendance aux benzodiazépines, ce qui a permis de diviser ce groupe consommateur en deux sous-groupes : trouble de l’usage probable et trouble de l’usage peu probable. Les prévalences de consommation et de trouble de l’usage ont ainsi pu être estimées. L’analyse statistique de l’étude a consisté en une étude descriptive de la distribution des variables en premier lieu. Des facteurs de risques de consommation ont également été recherchés par analyses univariée et une analyse multivariée comparant les groupes consommateur et non-consommateur.
Résultats : La prévalence de consommation de benzodiazépines est de 7.4% [5.7%-9.3%]. Celle du trouble de l’usage est de 3.4% [2.46%-4.29%], pour une valeur seuil de 23 au « Benzodiazepine Dependence Questionnaire ». L’analyse multivariée a retrouvé trois variables associées significativement à la consommation de benzodiazépines : un bas niveau d’éducation (p-value = 0.028, OR=2.878) ; un événement de vie négatif (p-value > 0.001, OR=3.655) et la présence d’un proche qui consomme des benzodiazépines (p-value > 0.001, OR=3.722).
Conclusion : La prévalence et l’épidémiologie de la consommation et du trouble de l’usage des benzodiazépines dans l’échantillon étudié est conforme aux chiffres de la littérature. La présence d’un proche consommateur de benzodiazépines semble être un facteur de risque de consommation.
Prix des Chefs de clinique-assistants
(CO2-6) La modélisation computationnelle pour différencier les sous-types de troubles bipolaires
POUCHON A. (1,4), VINCKIER F. (2), DONDÉ C. (1,5), GUEGUEN M. (3), BASTIN J. (5), POLOSAN M. (1,5)
(1) CHU Grenoble-Alpes, La Tronche, France;
(2) Motivation, Brain & Behavior (MBB) lab, Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM), Hôpital de la Pitié -Salpetrière, Paris, France;
(3) Department of Psychiatry, University Behavioral Health Care, & the Brain Health Institute, Rutgers University—New Brunswick, Piscataway, USA, New Brunswick, Piscataway, Etats-Unis;
(4) Univ. Grenoble Alpes, Inserm, U1216, CHU Grenoble Alpes, Grenoble Institut Neurosciences, Grenoble, France;
(5)Univ. Grenoble Alpes, Inserm, U1216, CHU Grenoble Alpes,Grenoble Institut Neurosciences, Grenoble, France;
Objectif : Le trouble bipolaire (TBP) est défini par l'alternance d'états dépressifs et (hypo)maniaques entrecoupé de périodes d’euthymie. Le programme Research Domain of Criteria (RDoC) propose d’étudier la récompense et l’apprentissage par renforcement dans le domaine des systèmes de valence positifs, cette dimension se montrant intéressante dans l’étude des TBP. La modélisation computationnelle est une approche originale et peut aider à mieux comprendre la physiopathologie des TBP, et ainsi aider à contribuer au débat quant à une hypersensibilité ou une hyposensibilité à la récompense dans les TBP en période euthymique. Les sous-types du trouble bipolaire pourraient être conceptualisés comme un spectre de troubles dans lequel la sensibilité à la récompense serait une dimension clé de la pathologie. Ici, nous examinons séparément l’apprentissage de la récompense et de l'évitement de la punition à l’aide de modélisation computationnelle, à la recherche de biomarqueur selon le sous-type de TBP, la littérature semblant suggérer une différence entre les deux sous-types.
Méthode : Pour cette étude transversale, nous avons inclus 45 patients atteints de trouble bipolaire de type I (TBP-I), 34 patients atteints de trouble bipolaire de type II (TBP-II) et 30 sujets sains (HS). Les participants ont effectué une tâche comportementale d'apprentissage par renforcement explorant séparément le traitement de la récompense et de la punition. Nous avons utilisé un modèle computationnel d'apprentissage par renforcement pour explorer ces résultats à trois paramètres libres.
Résultats : Les résultats comportementaux ont montré une différence entre les deux sous-types de TBP et les HS dans l'apprentissage de la récompense (F(2,106)=11.6; p= 2.8*10-5). Dans l'apprentissage de l'évitement de la punition, les performances des patients TBP-I étaient significativement plus élevées et plus efficaces que celles des patients TBP-II (BD-I vs. BD-II: t(77)=2.5; p<0.05). La modélisation computationnelle nous a indiqué que le déficit d'apprentissage basé sur la récompense observé dans les deux sous-types de TBP par rapport à l'HS était spécifiquement capturé par un paramètre de magnitude de renforcement (R) (sensibilité à la récompense) plus faible (R; F(2,106)=10.2; p=9.10-5), et que le déficit d'apprentissage par évitement de la punition dans les TBP-II par rapport à TBP-I était spécifiquement capturé par des choix aléatoire (ß) plus élevé dans le groupe de TBP-II par rapport au groupe TBP-I (F(2,106)=4.52; p=0.01).
Conclusion : La modélisation computationnelle nous a permis de conclure à une hyposensibilité à la récompense dans les TBP, soutenant cette théorie qui contredit le modèle d'hypersensibilité à la récompense. Nous avons constaté que les patients atteints de TBP ne diffèrent pas de HS en termes d'évitement de la punition, à la différence du trouble dépressif récurrent, mais les deux sous-types différant du fait de choix plus hasardeux dans le TBP-II.
Prix de la Revue
Cette année, Astrid Chevance et Wissam El-Hage reçoivent le prix de la revue ex-æquo !
Ensuring mental health care during the SARS-CoV-2 epidemic in France: A narrative review
Astrid CHEVANCE, Paris, France et al.
Les professionnels de santé face à la pandémie de la maladie à coronavirus (COVID-19) : quels risques pour leur santé mentale ?
Wissam EL-HAGE, Tours, France et al.
Heureux de recevoir le prix de la revue Encéphale @encephaleonline ex-æquo avec @ChevanceAstrid Félicitations Astrid@iBrain_Inserm @UnivTours @CHRU_Tours pic.twitter.com/HS88uLkC7U
— El-Hage Wissam (@ElHageWissam1) January 21, 2022
Prix des start up en santé mentale
Prix du Comité Scientifique
RESILEYES THERAPEUTICS
Prix du public
APNEAL
Prix du Teaser
Ready Psy One, l'Odyssée de la psychiatrie
Olivier GUILLIN et al. , Rouen, FRANCE
La Battle de l'Encéphale 2022 : No time to lose
Antoine BALDACCI, Camille BEAL, Camille CHARVET, Jean-Del BURDAIRON, Paris, France






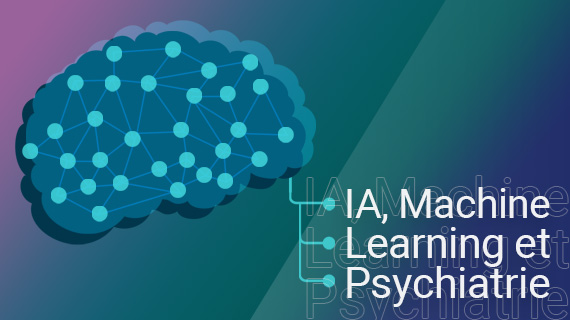
Les résultats de l'enquête PsyCan sur la légalisation du cannabis
Léa LECLERC (Lyon)
Replay disponible prochainement sur l'Encéphale online