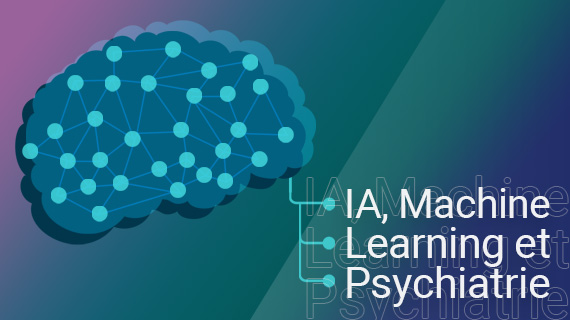Femme et sommeil : de la physiologie à la pratique en médecine du sommeil
Le sommeil des femmes est marqué par des variations hormonales et des spécificités biologiques tout au long de leur vie. Cette session a exploré les interactions entre physiologie hormonale, troubles du sommeil, et leur prise en charge.
Femme et sommeil
Christine Rousset Jablonski (HCL, Lyon) a exposé les influences des hormones sur le sommeil à différentes étapes de la vie et leur possible impact sur le sommeil :
- Puberté : L’activation de l’axe gonadotrope initie des cycles hormonaux. La phase lutéale (dominée par la progestérone) est associée à une diminution du sommeil paradoxal (SP).
- Ménopause et Péri-Ménopause : Les fluctuations hormonales entraînent des troubles vasomoteurs, une hyperostrogénie relative, et des insomnies (Soules et al., 2001 et Harlow et al., 2012). En phase de ménopause installée, l’hypoestrogénie peut aggraver ces symptômes, tandis que le traitement hormonal substitutif (THM) peut améliorer le sommeil, possiblement du fait de ses effets sur les troubles vasomoteurs.
- Grossesse : L’augmentation des taux d’œstrogènes et de progestérone altère la qualité du sommeil, particulièrement en fin de grossesse. Les insomnies et la somnolence diurne sont fréquentes, pouvant impacter la santé maternelle et néonatale (Izci et al., Eur J.Respir, 2006).
Différences de genre dans les troubles du sommeil
Isabelle Lambert (CHU, Marseille) a souligné les particularités des troubles du sommeil chez les femmes :
- Insomnies : Les femmes rapportent jusqu’à 40% plus de plaintes d’insomnie que les hommes (Mong et al., 2011). Ces troubles sont souvent exacerbés en périodes de fluctuations hormonales, comme la péri-ménopause, où les troubles vasomoteurs aggravent les difficultés d’endormissement et la fragmentation du sommeil.
- Syndrome des jambes sans repos (SJRS) : Plus fréquent chez les femmes. (Mallampati et Carter, 2014).
- Hypersomnies idiopathiques : Plus fréquentes chez les femmes, elles se traduisent par une fatigue chronique, des plaintes de somnolence excessive, et un impact fonctionnel marqué. Ce trouble est souvent mal diagnostiqué en raison d’une association fréquente avec des troubles de l’humeur.
- Réponses thérapeutiques : Les différences biologiques influencent également les traitements. Par exemple, la métabolisation du zolpidem est 50% moins importante chez les femmes, nécessitant une adaptation de doses (Mallampati et Carter, 2014).
Femmes et SAOS
Wojciech Trzepizur (CHU Angers) a décrit les spécificités des femmes atteintes de syndrome d’apnées obstructives du sommeil (SAOS) :
- Symptômes différents : Contrairement aux hommes qui présentent principalement des ronflements et de la somnolence, les femmes souffrent davantage d’asthénie, de troubles de l’humeur, d’insomnie, de céphalées et de cauchemars. Ces différences peuvent expliquer un diagnostic tardif (Bonsignore et al., ERJ, 2019).
- Phénotypes distincts : Les femmes présentent davantage d’hypopnées et de micro-éveils, souvent en sommeil paradoxal, alors que les hommes montrent des apnées plus longues et plus fréquentes (Bonsignore et al., ERJ, 2019).
- Facteurs de risque : La ménopause semble jouer un rôle clé dans l’augmentation du SAOS chez les femmes, en raison de la prise de poids centrale et des perturbations hormonales (Lindberg et al., SMR, 2020). Cependant, l’impact du vieillissement semble moins marqué chez les femmes que chez les hommes (Redline et al., Sleep, 2003 et Newman et col., Am J Epidemiol, 2001).
- Traitements : Les femmes répondent généralement bien aux dispositifs de pression positive continue (PPC), bien que des ajustements spécifiques soient nécessaires pour optimiser l’efficacité (Gerves-Pinquier et al., AJRCCM, 2022)
Femmes et hypersomnie centrale
Isabelle Arnulf (Hopital de la Pitié Salpêtrière, Paris) a abordé les hypersomnies centrales et leurs spécificités chez les femmes :
- Narcolepsie : Les femmes atteintes de narcolepsie présentent des symptômes plus précoces et un impact fonctionnel plus important (Luca et J Sleep Res, 2013). Elles rapportent également un taux élevé de dépression associée (Ingravallo, J Sleep Res, 2024).
- Le Syndrome de Klein Levin : Identifié historiquement comme un diagnostic uniquement masculin, il est aussi un trouble pouvant toucher les femmes (37% de femmes) (Lavault, Ann Neurol, 2015).
- Contraception et hypersomnie centrale : Modafinil (inducteur du Cytochrome P450) est compatible par une contraception microdosé (dont la dose est doublée) ou le stérilet pour nullipare (Roberston, Clin Pharmacol Ther, 2002). Les autres traitements éveillant (Pitolisant, Oxybate de sodium, Solriamfétol, Méthylphénidate et Amphétamine) sont compatibles avec les oestroprogestatifs
Conclusion et perspectives
Les intervenants ont souligné le fait que le sommeil des femmes est influencé par des interactions complexes entre hormones, facteurs biologiques et contextes socio-environnementaux et que la recherche doit intégrer ces spécificités en considérant le genre comme une variable dans l’étude et la prise en charge des troubles du sommeil.
Compte-rendu d'une session présentée lors du Congrès du Sommeil 2024, Lille 20-22 novembre 2024
Avec le soutien institutionnel de :

Attention cette publication est un compte-rendu de congrès qui peut contenir des informations hors autorisation de mise sur le marché