Génération Hikikomori : Commentaire d'ouvrage
Marie Jeanne GUEDJ BOURDIAU commente l'ouvrage "Génération Hikikomori" de Nicolas Tajan
Cet ouvrage extrêmement complet est issu d’un travail de thèse de psychopathologie de l’Université de Toulouse le Mirail. L’auteur utilise une méthode tenant de l’anthropologie/ethnologie participante et de la psychanalyse. Il a effectué un vaste travail d’enquête à travers de nombreux ouvrages recensés dans la bibliographie, à travers les ressources des medias, et par le truchement de nombreux entretiens de terrain.
Que se cache-t-il derrière les hikikomori (HKM) ? Selon la définition du Ministère japonais en 2010, ce sont des jeunes âgés de 14 à 25 ans, voire 18 à 35 ans, qui passent la majeure partie de leur temps au domicile, en évitant toute participation sociale habituellement significative (études, travail relations). Ils sont dans cette situation depuis au moins 6 mois, n’ont pas ou ne voient plus d’amis proches. Ils ne présentent pas d’incapacité physique ni non plus de pathologie psychiatrique s’assimilant à une schizophrénie évidente (diagnostiquée).
Ce problème, par essence caché, entraîne que toute rencontre avec des personnes HKM signifierait déjà qu’elles ne le sont plus « le HKM pur ne peut être rencontré ». D’une autre manière, il existe des sous-populations dites cachées d’HKM, non comptabilisées comme telles, ainsi en est-il des phobiques sociaux, des taijin kyofusho ou anthropophobiques, des addicts à Internet, des femmes ne sortant pas de la maison.
Selon l’auteur voici les caractéristiques des HKM :
- La plupart ont une expérience d’absentéisme ou de décrochage scolaire, dans le cadre d’une rupture dans le passage entre lycée et collège…
- Ils ne sont pas reçus par les psychiatres ou psychologues mais plutôt par les NPO (non paid organizations) qui reçoivent 1/3 de troubles psychiatriques
- La présence d’anciens HKM dans l’assistance aux jeunes enfermés est importante
- C’est un moment dans un processus de subjectivation
- Il concerne plutôt les adultes émergents.
Le projet de l’auteur a quelque chose de militant : faire admettre, avec le monde des hikikomori décrit comme produit de la culture japonaise et devenu un vaste « business », l’existence de la psychologie et de la psychologie scolaire, voire même de la psychanalyse dans le monde japonais. Comment le Japon en est-il arrivé là, se demande l’auteur ? Quel contexte sociologique singulier a pu favoriser cette sortie du monde en même temps que cette agression d’allure passive contre le monde et contre la famille ?
Le psychanalyste Marie Jean Sauret signe une postface où il note que l’auteur fait du HKM l’index d’un réel en examinant les discours de tous ceux qui ont affaire à lui outre la psychiatrie, la psychologie, la pédagogie, les études japonaises, l’ethnologie, l’anthropologie… Problématique charnière entre transgénérationnel et subjectif impliquant une jouissance, le HKM rejoint d’autres concepts tels que le cadavre dans le placard, le patient désigné, les secrets de famille et non-dits, « le symptôme de l’enfant se trouve en place de répondre à ce qu’il y a de plus symptomatique dans la structure familiale ».
Il reste néanmoins difficile d’échapper à l’ambiguïté de ce thème venu en force en Occident et dans le monde. Par le mot HKM on désigne à la fois le phénomène d’enfermement et la personne qui est enfermée, très différemment du vieux mot de claustration jusque-là utilisé dans la littérature psychiatrique. Le rapport avec la pathologie reste difficile à trancher : est-ce une maladie ? Est-ce parfois associé à une pathologie ? Ou doit-on quitter ces catégories ?
Les questions sociologiques sont longuement décrites, par exemple :
- Ce sont des populations de classes moyennes et supérieures qui ne livrent pas leurs secrets. « La classe moyenne, c’est à dire la classe sociale la plus visible, rend invisibles ceux qui parmi elle sont en souffrance, et ce d’autant plus qu’ils s’excluent d’une valeur centrale réunissant tous les autres, le travail »
- Une attention particulière est portée à l’héritage des traumatismes sociaux, tels les guerres, mais aussi les mouvements économiques y compris le reflux post expansion des années 90.
Peut-on aujourd’hui, et après cette lecture, favoriser une comparaison France-Japon voire Corée ?
- L’équipement et le positionnement de la psychiatrie au Japon sont très différents : fortement stigmatisés du côté de la psychiatrie hospitalière en charge des maladies sévères (le nombre de lits de psychiatrie est le triple), sans médecin de famille, sans collaboration avec les psychologues uniquement concernés par le monde du travail ou celui de l’école, elle serait peu touchée par ce phénomène. En revanche en France, la place des associations privées non psychiatriques reste marginale
- Au Japon ce phénomène est si connu socialement que de nombreux Japonais, normalement sains et insérés, expriment sans honte l’existence d’une période de HKM dans leur histoire
- Le mode d’approche par les NPO (non paid organization) telles New Start, dans un pays qui ignore la psychiatrie de secteur, n’est pas sans rappeler la psychiatrie institutionnelle née après-guerre à Saint Alban, voire les associations d’inspiration communautaire antipsychiatrique : café, lieux d’hébergement et appartements, rencontres avec les parents, visites à domicile, voire hospitalisation. Il est parfaitement mis en scène par l’auteur de théâtre IWAI. Il existe par exemple en Corée une idéologie militante issue du marxisme pour ces associations privées d’aide aux HKM
- Sortir de l’enfermement est bien la question posée, et pour les Coréens le délai devrait être ramené à 3 mois d’enfermement, loin d’un certain droit à la paresse ou d’une misanthropie à vivre qu’ont pu soutenir des medias occidentaux. La comorbidité psychiatrique, le parallélisme ou non avec la gravité de l’enfermement, sont des questions abordées différemment au Japon, en Corée, en France.
Au total, c’est pour décrire au mieux le carrefour où se situe ce phénomène, la place de langage social qu’il occupe, d’«idiome de détresse », en même temps que la tentative d’une question du sujet que la lecture de cet ouvrage est à recommander.
Dr Marie-Jeanne Guedj
Génération HikikomoriAuteur : Nicolas Tajan Éditions : L'Harmattan Juin 2017 - 384 pages EAN 13 : 9782343123561 |
|
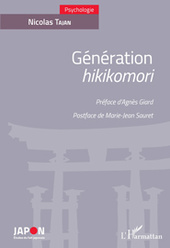





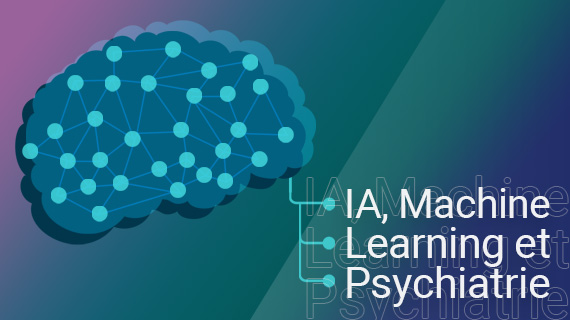
0 commentaire — Identifiez-vous pour laisser un commentaire