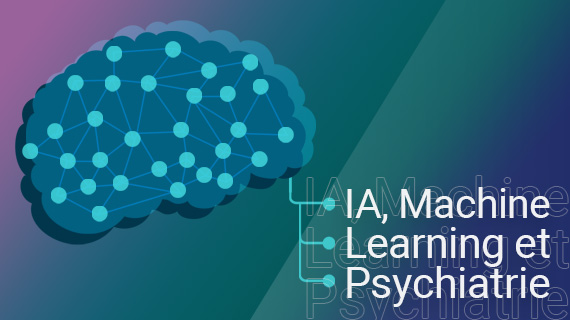Le stress au travail - Un enjeu de santé
Si le début du siècle dernier a été marqué par les contraintes physiques imposées à l’homme par le monde de l’industrialisation, notre XXIème siècle est lui confronté à l’émergence du stress psychologique au travail.
L’ouvrage de Patrick Légeron est un condensé des connaissances sur le stress depuis sa conceptualisation par Hans Seyle à son apogée actuelle dans le burn out. Très tôt Patrick Légeron a eu le mérite de se lancer dans l’analyse de ce changement qui s’opérait dans le monde des entreprises. Psychiatre formé en France et aux Etats-Unis, il a vu venir cette vague qui maintenant touche toutes les entreprises sous des formes diverses. Son expérience en tant que clinicien hospitalier et celui de consultant dans les entreprises, lui a conféré un regard critique sur l’évolution du concept de stress. Son premier ouvrage sur le stress au travail en 2001 faisait déjà de lui un précurseur dans le domaine et c’est sans surprise qu’il fut le coauteur avec Philippe Nasse du premier rapport en France sur les risques psychosociaux remis au ministre du travail en 2008.
Qui mieux que lui pouvait donc parler du stress sous tout ses angles ?
Dans cet ouvrage de près de 400 pages, ce sont aussi bien les aspects symptomatiques que le coût du stress ou encore les risques pour notre société qui sont détaillés.
Dans un premier temps, Patrick Légeron nous dévoile le stress sous forme de vignettes cliniques plus criantes de vérité les unes que les autres ; nous y retrouvons le quotidien de ce que nous pouvons entendre lors de consultations de patients en souffrance dans leur travail. Ces vignettes sont des portes d’entrée pour mettre en exergue les différents stresseurs modernes que sont la surcharge de travail, les changements incessants, les conflits de personnes, l’absence de contrôle, le manque de reconnaissance…
Dans un deuxième temps, c’est tout le mécanisme du stress qui est étudié, nous y retrouvons la description de l’analyse princeps de Hans Selye dès 1936, puis la description méthodique des mécanismes physiopathologiques qui vont intervenir. Les aspects psychologiques reprennent les travaux précurseurs et toujours d’actualité du modèle transactionnel de Lazarus avec notamment la notion de double évaluation cognitive et les stratégies de coping. Les notions de perception du stress, d’impuissance apprise ou de contrôle sont reprises. Les modèles ergonomiques du stress au travail comme de celui de Karasek avec son Job Strain sont présentés. Ces différents modèles médicaux, psychologiques et ergonomiques amènent à une meilleure compréhension du stress et de son fonctionnement sur l’individu.
C’est donc tout naturellement que le stress est alors étudié sous l’angle des conséquences qu’il peut entrainer chez l’homme. Les différentes pathologies psychiatriques pouvant émerger lors de stress chroniques sont présentées comme les troubles de l’adaptation, la dépression, l’anxiété généralisée… mais ce sont surtout ces nouveaux concepts comme le burn out qui sont expliqués. Le burn out apparaît aujourd’hui comme un concept aux contours flous dont l’auteur nous permet une vision plus claire en le ramenant à sa conceptualisation initiale par Herbert Freudenberger puis au développement de sa compréhension par les travaux de Christina Maslach dans les années 80. Il existe une kyrielle de symptômes possibles associés à un burn out. L’auteur rapporte que l’épuisement professionnel serait lié à l’individu pour 40 % et à des facteurs organisationnels pour 60 %.
Le concept plus récent du bore-out est évoqué. L’auteur insiste sur le risque final de cette confrontation de l’individu aux stresseurs professionnels qu’est le suicide en prenant garde de ne pas tomber dans le piège d’un raccourci trop facile d’attribuer tout suicide d’un salarié comme étant dû au travail. Les facteurs responsables d’un suicide sont multiples et il conviendrait, comme de nombreux autres pays, de pouvoir réaliser des autopsies psychologiques afin que la part liée au travail soit correctement attribuée.
Mais ce ne sont pas que les seuls troubles psychiatriques ou psychologiques qui sont présentés. Le stress est tenu pour responsable de pathologies organiques avec en tout premier lieu les pathologies cardiovasculaires, les troubles musculo-squelettiques et des questions demeurent sur les liens entre stress et cancer.
Le stress a un coût mais pas uniquement en terme de maladie pour les individus. Les conséquences financières sont lourdes que ce soit par l’absentéisme, les accidents du travail ou le coût des maladies qu’il peut favoriser.
L’entreprise est donc face au stress, comme le titre la quatrième partie du livre. Les risques psychosociaux sont connus et l’auteur pointe le premier d’entre eux : le stress. Mais pour que ces risques s’expriment il faut des facteurs déclenchants. Les facteurs de risques psychosociaux sont définis par 6 catégories : les exigences du travail, les exigences émotionnelles, le manque d’autonomie et de marges de manœuvre, le manque de soutien social et de reconnaissance au travail, les conflits de valeurs, l’insécurité de l’emploi et du travail. L’auteur se lance dans une analyse du fonctionnement des entreprises au travers de l’organisation du travail, du management, de la gestion humaine du changement pour mettre en avant que le bien-être doit devenir une stratégie d’entreprise permettant d’apporter autant de bénéfices à l’individu qu’à l’entreprise elle-même.
C’est donc tout naturellement que Patrick Légeron termine son ouvrage sur une dernière partie concernant la gestion du stress. Cette partie donne une bonne place à la mise en application d’outils des thérapies comportementales et cognitives. La gestion du stress passe par les techniques de relaxation en décrivant les plus connues que sont celles de Schultz ou Jacobson. Une large partie développe les aspects cognitifs et les moyens à mettre en œuvre pour raisonner différemment. Les techniques d’affirmation de soi sont exprimées et les différentes stratégies à mettre en place pour augmenter sa résistance au stress sont présentées.
C’est donc un ouvrage très complet que Patrick Légeron présente en prenant le soin d’agrémenter son texte d’encarts cliniques, explicatifs, scientifiques ou de tests. La lecture en est facilitée par un langage clair, direct avec des définitions précises. Il s’agit d’une mine de connaissances qui fait un tour très complet des différentes facettes des stresseurs, des réactions physiologiques et psychologiques du stress et de ces nombreuses conséquences pour l’individu en tout premier lieu mais aussi pour l’ensemble de notre société. Le monde de l’entreprise a changé et Patrick Légeron en décrit parfaitement ses dangers avant de conclure : « Quant à nous, agissons pour que le travail soit le lieu de la construction de notre personne et non de sa destruction ».
Dr Frédéric CHAPELLE
L’auteur
Patrick Légeron est psychiatre à l’hôpital Sainte-Anne à Paris et fondateur de Stimulus, cabinet de conseil aux entreprises sur les problèmes du stress et du bien-être au travail. Pionnier et expert dans ce domaine, il est également l’auteur, avec Christophe André, de La Peur des autres.
Le stress au travail
|
Patrick Légeron |
|