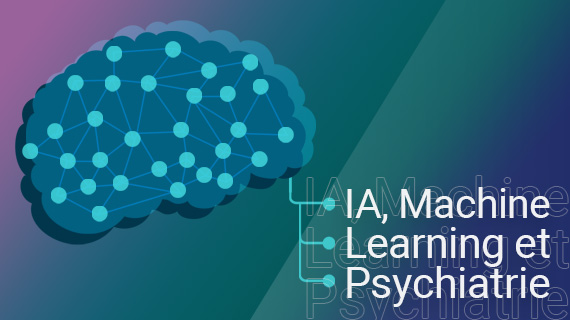Mais trop c'est trop - Commentaire de l'ouvrage "Médecine en danger, qui pour nous soigner demain ?"
Stéphanie Hahusseau commente le nouvel ouvrage de Jean-Christophe Seznec et Stéphanie Rohant paru en septembre 2016 : "Médecine en danger, qui pour nous soigner demain ?".
Par souci de l’humain, comme les mères et les prêtres, les médecins se mettent au service des autres en faisant taire leurs besoins.
Au cours de leurs études, ils doivent apprendre à faire face à la mort et à la souffrance dans un contexte souvent hiérarchisé et émotionnellement maltraitant. Ils apprennent l’humilité voire l’humiliation. Ils s’adaptent, mettent leurs émotions de coté car leur vocation est la plus forte.
Face à la misère du monde, le médecin culpabilise. Il minimise la gravité de "ses petits problèmes" au regard de la détresse qu’il côtoie tous les jours.
Élevé dans des références de continence émotionnelle, il se néglige et on le lui rend bien. À force d’être le récipiendaire de toutes les velléités de contrôlabilité du monde alors qu‘il s’épuise à la tâche et qu’évidemment il n’apporte qu’une petite contribution à l’évolution de celui-ci, il perd progressivement confiance dans son sentiment d efficacité personnelle. La médecine, c’est beaucoup d’incontrôlable. Or l’incontrôlable génère du stress. Personne n’écoute les médecins, surtout pas les politiques, ni ne les aide à repérer et accepter leurs émotions. Pour cause, leurs existences et les lois de régulation auxquelles elles sont soumises n’ont jamais été abordées dans les études de Médecine.
Seuls, identifiés comme devant veiller à celles des autres mais ne bénéficiant pas de la bienveillance qu’ils manifestent aux autres, ils sont entraînés à réprimer leurs émotions pourtant de plus en plus nombreuses.
Outre ces exigences émotionnelles, le Ministère du travail décrit comme facteurs de risque concourant au burn-out les exigences professionnelles, le manque d’autonomie et de marges de manoeuvre, le manque de soutien social et de reconnaissance, les conflits de valeur.
Or les médecins les cumulent presque tous !
Les administrations y concourent tranquillement et surement. Toujours plus de travail administratif, toujours plus de restrictions budgétaires. Toujours moins de moyens. Les médecins du public dénoncent ces faits depuis un certain temps mais les réquisitions en cas de grogne généralisée la rendent invisible.
Les administrations externalisent les causes de leur incapacité à enrayer un déficit dû à leur politique à court terme. Dans cette perspective, comment imaginer une reconnaissance notamment financière ? Renvoyés à l’auréole d’un statut financier et de privilèges dont ils n’ont jamais bénéficié, les médecins eux-mêmes n’osent même pas la réclamer.
Toujours plus d’injonctions contradictoires.
Comme de plus en plus d’entreprises, elles veulent des économies de santé là tout de suite maintenant, raisonnent dans l’immédiateté, empêchent toute créativité, tout investissement qui pourraient générer des bénéfices à plus long terme.
Les administrations, relayées par les médias, alarment sur le coût et la sur-prescription de psychotropes désignant les médecins généralistes et les psychiatres comme responsables. Les psychothérapies brèves sont une alternative ayant fait preuve d’une efficacité à moyen et long terme supérieure à celle des psychotropes dans la plupart des troubles. Les études canadiennes ont même démontré qu’elles rapporteraient deux fois plus qu’elles ne coûteraient à l’organisme de santé qui les rembourserait. Mais leur remboursement est refusé.
Quels sont dès lors les choix thérapeutiques du psychiatre qui voudrait satisfaire le respect des données de la science, assister des personnes en danger et rester dans la légalité ? L'apposition des mains ? Les bains de siège ?
À la moindre innovation amenant des saillances administratives ou comptables donc considérées comme déviantes, les administrations n’hésitent pas à suspecter de fraude ou à porter plainte contre les médecins. Elles ne rencontrent pas les médecins, elles les assignent, sous prétexte d’exemplarité.
Le Non bis in idem, principe de droit intraitable pour tout le reste de la population ne s’applique pas aux médecins qui peuvent être jugés trois fois pour les mêmes faits.
Les médecins libéraux sont isolés. Leurs données et leur savoir faire ne sont jamais étudiés. Qui financerait la recherche ? Qui veillerait pendant ce temps à leur sécurité financière ? Où sont les structures de formation ou d’échanges dans la mixité des spécialités ? Par exemple, les principes de la régulation émotionnelle ont tout à voir avec les circuits de la nociception. Où sont les modalités d’échanges transdisciplinaires ? Pas les financements dans le public (à quel service rattacher le psychiatre qui travaille dans différents services ?) et pour les libéraux qui n’ont pas de vacation, les frontières privé-public sont étanches.
Compte-tenu des difficultés à faire ce métier en dilettante, la vie privée en pâtit. Les médecins font partie des professions les plus exposées au risque de divorce. Encore davantage si ce sont des femmes. Et je ne m’étendrai pas sur toutes les restrictions ubuesques logistiques et pécunières subies jusque là par les mères médecins célibataires.
Tous ces facteurs ajoutés les uns aux autres sont responsables d’un taux de burn-out qui dépasse l’entendement. Une sorte d’indifférence émotionnelle s’installe à bas bruit. Plus d’empathie pour soi, plus d’empathie pour les autres. Alors que l’empathie améliore les résultats thérapeutiques, l’observance, et même la santé physique des patients, on est dans l’usure de compassion. Même les valeurs en viennent à s’étioler.
La médecine est en danger. Nous sommes en danger.
L’excellent livre de Jean-Christophe Seznec et Stéphanie Rohant est un indispensable cri d’alerte. Ce livre documenté dénonce des injonctions paradoxales, des mesures administratives kafkaïennes. Il pointe du doigt la menace dans laquelle nous sommes. Il amène le sentiment de ne plus être seul à batailler avec des hiatus inextricables. En creux, il nous incite aussi à porter un regard sur notre état de santé notamment psychologique, examen dont nous ne sommes pas coutumiers. Merci à eux d’avoir eu ce courage.
Docteur Stéphanie HAHUSSEAU
Psychiatre-psychothérapeute, Paris
Médecine en danger
Qui pour nous soigner demain ?
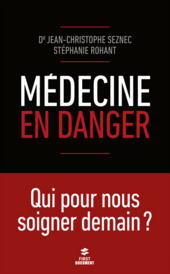
|
Auteurs : Jean-Christophe Seznec, Stéphanie Rohant Éditions : First Septembre 2016 - 288 pages ISBN : 978-2-7540-8446-8 |