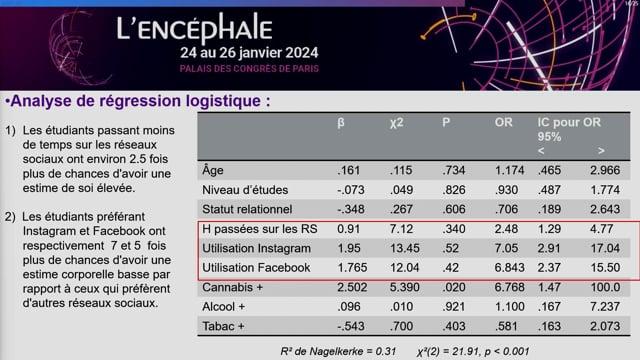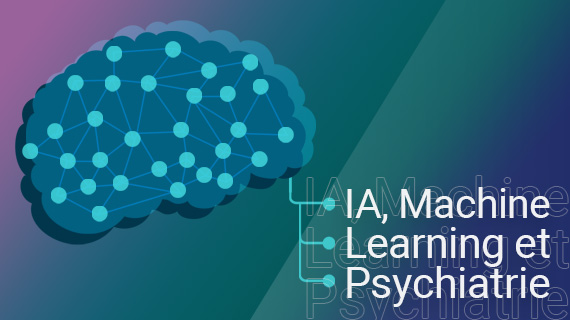COVID-19 et complications neuropsychiatriques
Compte rendu des sessions sur le thème de la COVID-19 au Congrès de l'American Psychiatric Association 2022 (Nouvelle-Orléans, USA, 21-25 mai 2022), proposé par Anne-Cécile Petit.
Lors de la session consacrée au « brouillard cognitif » (brain fog), le Dr Durga Roy, directrice médicale au Johns Hopkins Bayview Neuropsychiatry Clinic à Baltimore, a fait le point sur les connaissances actuelles sur le COVID long.
Définition et facteurs de risque de COVID long
Le COVID-19 est caractérisé par 3 phases symptomatiques : la phase aiguë, jusqu’à 4 semaines après infection, une phase post-aiguë, avec la persistance de séquelles de la 1ère phase pouvant aller jusqu’à 12 semaines post-infection, et enfin la phase chronique, avec une persistance de symptômes 12 semaines après l’infection, qui correspond au « COVID long ».
Il existe différents facteurs de risque de développer un COVID long (Yong et al, Inf Dis, 2021 ; Su et al, Cell, 2022) : des caractéristiques socio-démographiques (âge, sexe féminin), certaines comorbidités (IMC élevé, diabète de type 2), la sévérité des symptômes initiaux (hospitalisation en réanimation, dyspnée à la phase aiguë, présence de plus de 5 symptômes à la phase aiguë, délire à la phase aiguë), mais également des paramètres biologiques (présence d’une virémie EBV, présence d’auto-anticorps).
Les troubles neuropsychiatriques sont les plus fréquents
Le COVID long est une entité hétérogène avec la persistance possible de différents symptômes : douleur thoracique, difficultés respiratoires, troubles digestifs, fatigue, anxiété et dépression, céphalées, symptômes cognitifs et myalgies (Taquet M et al, PLoS Med, 2021). Parmi ces symptômes, les symptômes d’anxiété et de dépression sont les plus fréquents et concernent plus de 20% des patients. En particulier, des troubles cognitifs, qui définissent ce que l’on appelle le « brouillard cognitif », peuvent être présents avec une altération de la planification, de l’attention, de la prise de décision, de la vitesse de traitement et de la mémoire.
La physiopathologie de ces troubles provient de trois mécanismes différents : les complications directes de l’infection, mais également des dommages cérébraux directs liés au neurotropisme du virus, ainsi que des dommages cérébraux indirects causés par l’état neuroinflammatoire. Le SARS-CoV2 pénètre le tissu cérébral via la muqueuse olfactive, gagne le cerveau par le bulbe olfactif puis peut s’étendre à l’ensemble du tissu cérébral, toutes les cellules du cerveau exprimant le récepteur ACE au virus.
Il a été montré récemment que l’infection à SARS-CoV2 entraine des modifications de la structure du cerveau avec une réduction du volume du gyrus parahippocampique et du cortex entorhinal (Douaud G et al, Nature, 2022).
Prise en charge
À l’heure actuelle, il n’existe pas de traitement validé dans la prise en charge du COVID long neuropsychiatrique. Il est nécessaire de cibler les symptômes spécifiques présentés par chaque patient, par exemple par des traitements antidépresseurs, des psychostimulants (methylphenidate, modafinil) ou encore des traitements neuroprotecteurs (donepezil, memantine). Une approche psychothérapeutique peut également être proposée, ainsi que de la remédiation cognitive ou de l’exercice physique.
Dr Anne-Cécile Petit
GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences
Ce contenu vous est proposé avec le soutien institutionnel de Janssen