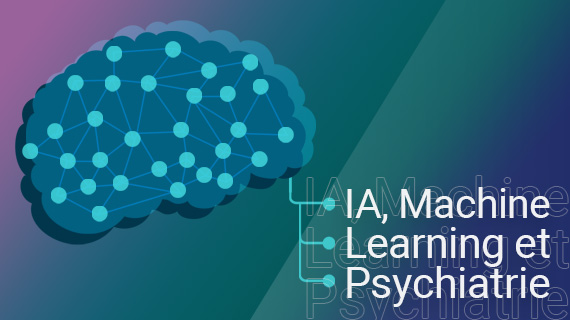Nouvelles tendances avec les approches numériques de TCC dans la prise en charge de l’insomnie
Conférence de Charles Morin, professeur et directeur du Centre d’Étude des troubles du sommeil et titulaire de la chaire de recherche du Canada en médecine comportementale du sommeil. Université de Laval.
Une collaboration Franco-Canadienne existe de longue date sur l’étude de l’insomnie.
Cette conférence du Congrès du Sommeil 2025 a rappelé les fondements de la TCC-I et ses étapes depuis les premières recommandations dans le traitement de l’insomnie chronique.
Une courte histoire de la TCC-I et comment cette thérapie est devenue le traitement de choix dans les guides de pratique clinique.
Ce sont souvent les difficultés diurnes qui amènent les patients à consulter ; ils souffrent de difficultés à fonctionner (énergie, cognition, humeur) avec un ressenti de détresse lié à une situation qui dure (> 3 mois pour l’insomnie chronique). Quand on parle de TCC-I, ce sont les facteurs qui perpétuent l’insomnie qui vont être pris en compte.
La TCC-I s’est constituée sur une vingtaine d’années. Les premières études dans les années 80 portaient sur la TCC-I de patients réputés souffrir d’insomnie primaire, forme rare de l’insomnie. Depuis les années 2000, les études ont porté sur des insomnies avec comorbidités, dites « de la vraie vie ».
Le fait de ne plus faire de distinction entre l’insomnie primaire et secondaire a beaucoup fait évoluer le concept d’insomnie. Par exemple, les cliniciens ont acté que le traitement de la dépression ne permettait pas de traiter l’insomnie et que cette dernière devait être prise en charge comme un trouble ou une maladie à part entière.
Un des effets les plus remarquables de la TCC-I est sa durabilité. De plus, elle a fait ses preuves chez des sujets souffrant de dépression, d’anxiété, de douleurs et de cancers. Cependant, tous les sujets ne sont pas répondeurs.
Même si la TCC est reconnue par les professionnels, elle est largement méconnue du public et peu accessible.
Les tendances actuelles vers les approches numériques et l’autosoin
Depuis 15 ans, une prolifération de consultations sur des plateformes dédiées et d’applications mobiles sont disponibles ; avec plus ou moins de rétroactions automatisées ou personnalisées et individualisées. Un grand nombre d’études a accompagné ce mouvement et les méta-analyses qui en sont issues indiquent une bonne taille d’effet mais un important drop out (25%) (Hwang JW Digit Med 2025); plus l’approche est automatisée et plus les risques d’abandon sont importants.
Que nous réserve le futur : est-ce que le numérique et l’IA vont remplacer le clinicien dans la prise en charge de l’insomnie ?
L’efficacité de la TCC-I en fonction de la modalité d’offre de soins montre une taille d’effet sur la sévérité de l’insomnie qui varie en fonction des modalités d’application de la thérapie. Le meilleur effet revient à la prise en charge en face à face, suivie par la TCC-I en groupe, puis la e-TCC-I couplée à l’intervention d’un thérapeute et en dernier la TCC-I entièrement sur le web qui ont néanmoins un bon niveau d’effet (Hasan 2025). Ces différentes modalités d’offre de soins ont leur place et se conçoivent dans une prise en charge par paliers, le face-à-face gardant la meilleure valeur ajoutée (Morin 2025).
Des algorithmes sont à l’étude, pouvant permettre de modifier en cours de thérapie les modalités de prise en charge de façon à améliorer les résultats.
Les cliniciens ont bien conscience que la TCC-I ne répond pas à toutes les situations d’insomnie et ne convient pas à tout le monde. D’autres thérapies déjà connues sont en développement pour l’insomnie (TCC de troisième vague). Le numérique et l’IA ont certainement une place, mais dans l’immédiat il s’agit de solutions complémentaires et non d’un remplacement de la TCC guidée par un clinicien.
Agnès Brion, médecin spécialiste en psychiatrie et médecin du sommeil
Avec le soutien institutionnel de :

Attention cette publication est un compte-rendu de congrès qui peut contenir des informations hors autorisation de mise sur le marché