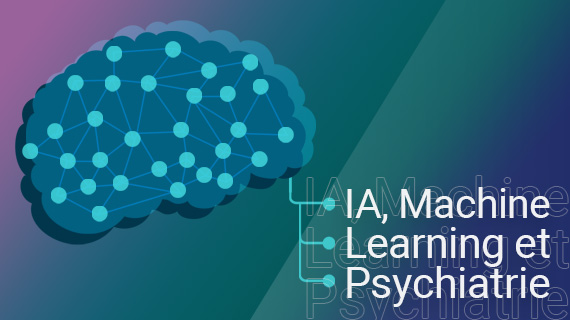Le sommeil comme baromètre de la pathologie
Décodage psy et sommeil
Ce symposium du Congrès du Sommeil 2025 était centré sur la façon dont le sommeil et sa régulation circadienne sont à la fois un baromètre pour le clinicien et un levier thérapeutique extrêmement sensible et indispensable dans la prise en charge des patients psychiatriques. Trois situations cliniques sont revisitées grâce à des données récentes pour une alliance toujours plus forte entre santé du sommeil et santé mentale.
Troubles du sommeil masqués : quand les plaintes de sommeil cachent l’essentiel
Pierre-Alexis Geoffroy (Centre Chronos, Bichat, Paris)
- Durée du sommeil et troubles de l’humeur : les données récentes en population générale montrent que des durées de sommeil très courtes (<5h) ou longues (>9h) sont reliées aux pathologies psychiatriques par une courbe en U (Geoffroy, 2020), comme c’est le cas pour des maladies somatiques, notamment cardiovasculaires et le diabète. Ainsi des sujets souffrant d’insomnie non traitée avec des durées courtes de sommeil présentent une prévalence élevée de troubles de l’humeur (33%), versus 7% chez ceux qui ne présentent pas d’insomnie (Grandner, 2023). Dans le cas d’une durée de sommeil très longue (patients souffrant d’une hypersomnie idiopathique), il est également retrouvé un surrisque de développer une dépression modérée à sévère : OR=7.68 ; et des pensées suicidaires : OR=1.68. (Barateau, 2025).
- L’étude objective du sommeil des patients déprimés remet en cause des idées reçues telles que l’attribution à une clinophilie, ou une recherche de refuge chez des patients déprimés avec une plainte d’hypersomnie. L’évaluation objective du sommeil montre que leur estimation de durée de sommeil est très proche de ce qui est objectivé sur des enregistrements, que ce soit pour la plainte d’insomnie ou sur des durées longues de sommeil. L’idée qu'insomnie et hypersomnie s’excluent mutuellement est également démentie par des enregistrements : certains sujets présentent des nuits reflétant une insomnie associées à une somnolence diurne objectivable (Bazin 2024).
- Dans le cadre d’un trouble de l’humeur, surveiller les modifications de la durée ou de l’organisation temporelle du sommeil permet d’anticiper des rechutes. D’autres troubles du sommeil peuvent être repérés plusieurs mois avant la rechute, permettant une anticipation très large et des mesures thérapeutiques précoces et individualisées. Ainsi, peuvent servir d’alerte l’apparition de parasomnies ou de mouvements anormaux liés au sommeil, par exemple (et de façon inattendue) un bruxisme (Basquin, 2024). Cette anticipation qui s’appuie sur de tels prodromes précédant les moments de bascule vers un épisode aigu est appelée syndrome de Chronos par les auteurs du travail présenté.
Les multiples visages du syndrome de retard de phase du sommeil (SRPS) chez l’adolescent
Sylvie Royant-Parola (Réseau Morphée, Paris).
Dans une perspective de prévention et de prise en charge pertinente des troubles du sommeil de l’adolescent, l’existence d’un syndrome de retard de phase du sommeil (coucher tard – lever tard) est à la fois fréquente (Stheneur 2019) et complexe à aborder dans toutes ses dimensions du fait de la fréquence des comorbidités psychiatriques et somnologiques associées.
- Décrit de longue date (Eliott Batman, 1979), le SRPS est fréquent car il correspond à des phénomènes de maturation du cerveau et du sommeil propres à cette tranche d’âge. Il se présente comme un retard à l’endormissement, une durée de sommeil normale pour la tranche d’âge et un réveil retardé. Il peut être accentué par les comportements et se confronte aux obligations scolaires entrainant une privation de sommeil qui va affecter négativement l’attention et la concentration, ainsi que la régulation émotionnelle jusqu’à entrainer une altération marquée de l’humeur.
- Le Trouble Déficit de l’Attention Hyperactivité (TDAH) qui touche environ 5% des adolescents avec une composante attentionnelle marquée chez l’adolescent est très souvent associé au SRPS. Il est aussi très lié au syndrome des jambes sans repos qui entraine lui aussi un retard à l’endormissement et un manque de sommeil. Ainsi l’existence d’un TDAH nécessite une évaluation somnologique approfondie (Gruber 2023). En partageant des mécanismes communs, les troubles s’aggravent mutuellement et leur prise en charge est complexe.
- Le SRPS chez l’adolescent requiert typiquement une approche thérapeutique multimodale (chronothérapie, prise en charge comportementale et psychologique ou psychiatrique parfois).
Les troubles du sommeil : une porte d’entrée pour explorer le psychotraumatisme
Julie Rolling (CRP Grand-Est, Strasbourg)
Les troubles du sommeil constituent des symptômes clés du trouble de stress post-traumatique (TSPT). Les personnes qui sont dans le psychotrauma sont souvent dans l’évitement des soins : explorer le sommeil est une porte d’entrée plus tolérable pouvant raccourcir le délai de prise en charge. De plus, les troubles du sommeil associés au TSPT sont de plus en plus considérés comme des facteurs de prédisposition et de maintien de la symptomatologie post-traumatique ; s’ils ne sont pas traités, le trouble persiste à long terme et la réponse aux thérapies est moins bonne.
- Les données objectives (polysomnographie) en population adulte font ressortir la dimension d’hyperéveil (augmentation de latence d’endormissement, fragmentation du sommeil, éveils pouvant être associés à des symptômes de panique ou d’anxiété). La fragmentation du sommeil par des éveils est associée à une sévérité du trouble et des symptômes de panique et d’anxiété.
- En population pédopsychiatrique, si le temps total de sommeil ne montre pas de différence significative par rapport aux témoins, il est retrouvé une fragmentation importante avec un index de microréveils plus élevé que la norme en 2ème et 3ème partie de nuit. Plus cette micro fragmentation est importante et plus elle est corrélée à la sévérité des cauchemars et notamment à l'item reviviscence des cauchemars traumatiques (Rolling, Schröder, 2023).
- Certaines études montrent également une augmentation de la densité des mouvements oculaires rapides des premiers épisodes de sommeil paradoxal (SP) permettant d’avancer l’hypothèse que le sommeil paradoxal est un espace de reviviscence du trauma plutôt que de régulation du matériel traumatique.
- Il s’ensuit deux cibles thérapeutiques de choix : l'insomnie et les cauchemars.
Agnès Brion, médecin spécialiste en psychiatrie et médecin du sommeil
Avec le soutien institutionnel de :

Attention cette publication est un compte-rendu de congrès qui peut contenir des informations hors autorisation de mise sur le marché